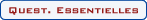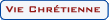17 décembre 2025 -
Sainte Olympe
17 décembre 2025 -
Sainte Olympe
Publié le : 31 janvier 2006 Source : Zenit.org
Les newsLe synode sur l’Eucharistie : un horizon pour accueillir l’Amour (2)ROME, Mardi 31 janvier 2006 (ZENIT.org) – Professeur de Théologie morale et sacramentaire à l’Institut d’Etudes Théologiques de Bruxelles, le P. Alain Mattheeuws, jésuite, a participé comme expert au synode sur l’Eucharistie. Nous l’avons interviewé longuement pour « revenir » sur l’expérience synodale et la réfléchir théologiquement. Voici la deuxième partie de cet entretien, que nous publions en trois volets. Zenit : On dit que ce synode n’a pas abordé les points difficiles ? P. A. Mattheeuws : Cette affirmation est un peu rapide. De nombreux débats ouverts ont eu lieu sur des questions délicates et difficiles : en aula (en congrégation, devant tous), dans les cercles mineurs (les sous-groupes), dans les discussions pour l’élaboration des propositions avec les évêques relateurs, les experts et les relateurs du synode. Selon les difficultés, il apparaissait que le point n’était pas résolu, pas mûr, peu susceptible de rassembler un assentiment convergent. Tout le monde ne réfléchit pas dans le même horizon théologique. Certains thèmes relèvent encore d’une étude plus approfondie et d’un temps nécessaire pour intégrer ces études. Ces remarques sont aussi valables du point de vue doctrinal que pastoral. Zenit : Vous pensez à quoi ? P. A. Mattheeuws : A un moment donné du Synode, tout en étant tous d’accord sur la présence réelle du Christ dans les espèces eucharistiques, le pain et le vin, il semblait difficile de trouver un langage commun pour « définir » et pour « rendre compte » de cette présence particulière. Le Seigneur est présent « là où deux ou trois sont réunis en son nom », il est présent dans le corps de son Eglise, il est présent dans sa Parole proclamée, entendue et vécue : comment est-il présent en son corps et en son sang ? Certains types de pensée ne parviennent pas à conserver et à enrichir une réalité dans la distinction. Il faut qu’ils séparent. D’autres voyagent facilement, affectivement et rationnellement, dans l’unité de ce qui est distinct. Pour les uns, il faut un moment « hic et nunc » de l’acte consécratoire ; pour d’autres, sans nier cette réalité de l’instant, l’action de l’Esprit dans un corps (personnel, communautaire, ecclésial) est discernée, approchée, goûtée dans une durée qui n’est pas d’abord de l’ordre d’un temps de l’horloge. C’est une sensibilité plus orientale, plus pneumatologique aussi. Ce point est manifeste dans la confrontation entre l’importance des paroles de l’institution et la présence des épiclèses. Il me semble que dans ce domaine, les réactions théologiques étaient peu élaborées, parfois trop émotives, pointillistes, avec le risque de « chosifier » l’action eucharistique. Autrement dit, il nous faut intégrer de meilleure manière la mission de l’Esprit dans l’acte du Christ et dans la mémoire que nous en faisons en Eglise. Zenit : N’avez-vous été surpris de l’abondance des questions concernant la manière de célébrer la messe ? P. A. Mattheeuws : Nous sommes à Rome et au milieu d’une diversité culturelle et surtout rituelle. Il est difficile de ne pas parler des significations que revêtent nos gestes et nos paroles dans la liturgie. Notre foi se nourrit de la variété des liturgies. L’insistance sur tel ou tel aspect doit être considéré d’abord comme une richesse : le respect ne se dit pas de la même manière en Inde ou en Europe. Pour marquer l’écoute, certains se mettent debout ; pour d’autres, c’est inconcevable : il faut s’asseoir pour montrer ainsi son humilité par rapport à la parole et à celui qui parle. Cette diversité est bien compréhensible. Il est normal aussi qu’elle se reflète dans la liturgie du patriarcat latin qui est répandu parmi tant de nations différentes. Zenit : Tous ne semblaient pas penser ou réagir comme vous… P. A. Mattheeuws : Le « rite » est une science du signe donné et reçu. C’est aussi dans certains textes un concept théologique. Le « rite » est distinct de l’observation des rubriques : de ce qu’il faut faire matériellement, de ce qu’il faut observer pour que ce soit bien fait selon les règles. Le « rite » est le chemin de la beauté. C’est en ce sens qu’il fallait d’abord comprendre l’Ars celebrandi : comment le prêtre et tous les acteurs de l’assemblée sont intérieurs au Mystère de telle manière qu’ils en vivent et en témoignent. Le « rite » compris ainsi est une « confession de foi ». Ce n’est qu’en ce sens que la lex orandi peut être la lex credendi tout en respectant toujours une herméneutique : une loi d’interprétation ecclésiale. Zenit : Et cette tendance à dénoncer tous les abus liturgiques ? P. A. Mattheeuws : Je vois ce à quoi vous faites allusion. Dans les discours et dans de nombreux textes, on insiste sur le respect dû à Dieu dans l’Eucharistie, dans la liturgie. On souligne ainsi le droit de Dieu. Quoi de plus normal ! Mais il y eut aussi quelques tornades affectives dans ce domaine. Des évêques, des pasteurs, sont blessés ou transmettent une souffrance entendue et veulent un respect plus rigoureux d’une manière de célébrer la Messe. Et il est bien vrai que nul n’est maître du Mystère ! C’est ce que certaines propositions tentent de dire, parfois maladroitement. Car certaines thématiques frisent les querelles de sacristie. A distance, on peut être étonné également par des insistances qui frisent l’objectivation et la chosification d’un Don qui nous dépasse tous. Faut-il passer son temps à défendre Dieu en sa blanche hostie quand il a voulu connaître l’obscurité et la faiblesse dans le sein d’une femme de notre race ? Faut-il réagir juridiquement quand les parcelles de son corps ou les gouttes de son sang semblent souffrir de nos maladresses ou de nos imprudences ? N’est-ce pas Lui qui a voulu et accepté de mourir nu sur une croix ? N’est-ce pas le Père à qui il s’est offert qui lui donne vie et puissance ? S’il nous faut l’accompagner dans cet acte unique du don de soi, faisons-le simplement et humblement. Ce ne sont pas ceux qui « crient Seigneur, Seigneur » qui le vénèrent et l’adorent en vérité là où il est et tel qu’il se donne. La vérité nous est offerte dans ce champ délicat pour l’affectivité spirituelle par la proposition 46 sur le sens des pauvres, des handicapés. La beauté de l’Eucharistie est dans le corps livré et le sang versé pour l’homme qui en est transformé. Zenit : Il apparaît, dans certaines conclusions, qu’on assiste plus à un statu quo qu’à de nouvelles orientations par rapport à l’Eucharistie : est-ce votre avis ? Peut-on parler d’un « retour du balancier » par rapport à des pratiques jugées trop déviantes ? P. A. Mattheeuws : L’année de l’Eucharistie avait déjà suscité de nombreuses publications et interventions dans toutes les parties du monde. Jean-Paul II avait publié une encyclique relativement originale mais qui ne reprenait pas tous les traits de la doctrine générale. La frustration de certains vient aussi de l’attente erronée ou bien de l’incompréhension des enjeux qui restent difficiles. Si des solutions aussi claires que ne le pensent certains médias étaient possibles et bonnes, si elles étaient clairement de l’Esprit Saint, elles auraient été prise ! N’en doutons pas. Sur certains points de doctrine, il y a eu approfondissement, partage d’expérience, assentiment ou prudence nouvelle. On a vu également, ce qui est très important, que les voix légalistes ou pessimistes, si elles sont tonitruantes parfois, ne représentent pas le sentiment « commun » des pasteurs. La réforme liturgique était un souci, mais nous avons entendu des interventions classiques, prudentes, ouvertes, positives sur l’importance des objectifs de Vatican II. Même si la mode est au compendium, dans le fond, chacun sait que ce n’est pas un livre qui change les cœurs : c’est l’Esprit et la grâce qui surgit de l’Eucharistie. Comme moraliste, je suis attentif à l’articulation entre l’Eucharistie et la vie chrétienne juste et sainte. Que ce soit pour la conscience personnelle (le discernement de nos propres fautes) comme pour la vie de charité (les œuvres bonnes à faire tant du point de vue individuel et social), il me semble qu’un hiatus demeure entre la grâce eucharistique et ses fruits. C’est bien sûr le chemin infini de la charité qui doit être mise en œuvre. C’est bien sûr le sens du péché et du pardon accordé. Dans ce domaine, il reste beaucoup à approfondir et à vivre. Peut-être faudrait-il être plus attentif au qualificatif employé par le pape en des circonstances diverses : « dynamique ». Il aime montrer que la paix est dynamique, que l’adoration est dynamique. Qu’est-ce que ce dynamisme sinon une « puissance de grâce » qui pousse l’homme à agir bien ? C’est dans l’articulation sacrement-morale que les enjeux sont décisifs et délicats : le service des pauvres et de la vie (Eucharistie et vie politique), la communion des divorcés-remariés, la communion entre chrétiens séparés, le service ecclésial rendu par les prêtres. Ces 4 thèmes délicats ont été discutés. On a avancé légèrement pour l’un et pour l’autre. Les évêques ont réaffirmé plus ou moins ensemble la position actuelle sur ces thèmes car il n’y avait pas d’alternatives théologiques et pastorales mûres et prêtes pour la discussion. Pour la découverte de « solutions » nouvelles et réalistes, il faudra partir de l’aspect « dynamique » de l’Eucharistie, comme le dit Benoît XVI. Il faudrait plus réfléchir la dimension de l’Acte du Christ Sauveur pour tous les temps. L’amour doit se mettre dans les actes plus que dans les paroles, dit Ignace de Loyola. Les paroles du Christ sont un acte sauveur. L’amour s’est dit « une fois pour toutes » en Jésus Christ. La récente encyclique du pape le souligne fortement. Zenit : Mais un « statu quo » n’est jamais bon ! P. A. Mattheeuws : Il y a plus qu’un « statu quo » : il y a une vie et un dynamisme dans ce qui a été échangé et assumé ensemble par les évêques. On ne mesure pas assez les différences culturelles, psychologiques, théologiques en présence et le lent travail qui est opéré dans les esprits et dans les cœurs. Les évêques perçoivent les chemins de miséricorde nécessaires, les options liturgiques potentielles, la puissance du Christ dans l’histoire. Il faut attendre l’heure de Dieu pour qu’elles prennent chair dans nos vies si différentes. C’est un Synode et non pas un Concile. Le processus synodal est consultatif et vise à un discernement ou à la découverte consensuelle d’une disposition ou d’une proposition dans un domaine particulier et pour le bien de l’Eglise universelle. Donnons un exemple de type liturgique et qui rende raison d’un souci légitime de régions différentes : si, pour certains, la pratique du jeûne eucharistique devrait être remise à l’honneur afin de mieux goûter et respecter la présence de Jésus et de communier avec les pauvres, pour d’autres, c’est la justice qui apparaît le fruit et la condition de la vérité de l’Eucharistie : ne demandez pas de jeûner à ceux qui déjà risquent de mourir de faim et qui font des kilomètres pour assister à l’Eucharistie. Zenit : Voyez-vous la source de certaines difficultés rencontrées et la cause de ce qui nous apparaît comme des impasses ? P. A. Mattheeuws : Il n’est pas aisé de faire un tel discernement et il faudrait revoir l’ensemble des documents car telle partie peut paraître plus faible ou moins développée, telle intuition être très présente dans l’intervention d’un évêque. Les théologies explicites ou implicites des « propositions » n’ont pas la splendeur du développement théologique du rapport du Cardinal A. Scola. Mais tout peut servir à « entrer plus profondément dans le Mystère ». A mon humble avis, des difficultés surgissent ou demeurent dans des questions variées pour deux motifs principaux. Le premier motif vient qu’on oublie trop facilement que l’Eucharistie, dans sa nouveauté cultuelle et de révélation, s’inscrit dans un repas cultuel et dans l’histoire sainte du peuple de Dieu : celui de la première alliance, celui de la nouvelle alliance. D’où pour certains la difficulté de percevoir l’importance de la « Table de la Parole ». Il nous faut aussi « manger » la Parole, le livre aux pages scellées qui nous est ouvert dans la célébration eucharistique. D’où pour certains la difficulté de percevoir l’engagement de liberté que suppose la « participation active et fructueuse » à la messe. Le deuxième motif confirme cette analyse : l’Eucharistie est le mémorial d’un acte unique du Fils de Dieu dans l’histoire. Elle est mémoire de l’acte du Christ sauveur. Si l’on parle d’un acte, d’une personne, du Fils offert, du Christ qui se donne pour le salut du monde, on perçoit plus rapidement combien nos actes nous engagent et comment le Christ agit sur nous durant la célébration eucharistique et quand nous le pouvons, dans la communion à son corps et à son sang. Zenit : Du point de vue théologique, qu’avez-vous remarqué comme faiblesses ? P. A. Mattheeuws : Après lecture des propositions et expérience faite, je ferais trois observations : a. Une méconnaissance ou une amnésie concernant le mouvement liturgique qui a abouti à la réforme conciliaire. Beaucoup de chrétiens en vivent et en sont heureux, mais ils ne savent pas pourquoi on célèbre ainsi maintenant et différemment d’il y a 50 ans. Cela vaut aussi pour les membres du Synode. Ceux qui regrettent le passé ou qui ont été blessés par des abus ou des erreurs, n’en savent pas plus. De part et d’autre, la nouveauté de la transcendance du Christ n’est pas perçue en profondeur et souvent le critère des deux commandements de l’amour n’est pas inscrit dans l’acte ou le jugement liturgique. b. Dans la prise de conscience de la place incontournable du ministre de l’Eucharistie, de la répartition des prêtres et de la question des vocations sacerdotales, on raisonne à partir du « manque » et non à partir de ce que Dieu donne déjà ou est en train de donner. Les critères restent extérieurs, utilitaristes et de militance. Les collaborateurs de l’évêque ne sont pas assez perçu comme un corps (un presbyterium), et le don du célibat est défendu encore de manière extrinsèque au sacrement de l’ordre Il est le plus souvent désarticulé du lieu où ce don est offert et éduqué (la famille, les cellules d’Eglise). Dès lors, il est peu mis en lien avec la vocation au mariage et n’éclaire pas la possibilité de ce sacrement d’être « transformé » par la grâce de l’ordination sacerdotale. Cette observation vaut pour l’Orient comme pour l’Occident. c. Dans de nombreuses interventions ou interprétations médiatiques, il me semble qu’il y a confusion entre le respect et le sens du sacré et ce qu’est la sacramentalité d’un geste ou d’un objet. Certains conservent ou développent un sens païen, latin au sens historique du terme, du sacré. La désarticulation de la foi des chrétiens par rapport à la racine juive ne peut qu’engendrer ce type de phénomène. Il y a un sacré qui est l’exact opposé du sécularisme : il est tout aussi nocif pour la foi. Les deux pôles se nourrissent mutuellement dans une dialectique pratique et pastorale que l’on peut voir avec surprise dans les jeunes générations ou dans certains mouvements d’Eglises. Zenit : Comment insister sur l’Eucharistie dans un contexte où les « ministres de l’Eucharistie » sont de moins en moins nombreux ? Est-ce là une caractéristique occidentale ? Quelle pastorale envisager pour les vocations ? Pourquoi avoir refusé d’élargir les conditions d’accès au sacerdoce ministériel ? P. A. Mattheeuws : Nous avons oublié que l’Eucharistie exprime de manière indépassable sur terre la joie du ressuscité : elle se célèbre par définition le Jour du Seigneur. C’est dans un contexte où le dimanche sera mieux compris dans toutes ses dimensions que la célébration sera plus vraie et que certaines questions pratiques se poseront différemment ou ne se poseront plus. L’enjeu est la consécration du temps de l’homme. C’est d’ailleurs la denrée rare et précieuse de la vie de l’homme. La faim de l’Eucharistie ne surgit pas dans n’importe quel contexte. C’est ainsi qu’il faut accepter et vivre nos pauvretés et nos richesses sur la terre. Le Seigneur ne nous a pas promis non plus un « quota » de prêtres fixé par la Commission Européenne ou par le Vatican. Les évêques ont ressenti douloureusement la question du manque de « ministres de l’Eucharistie ». Mais les situations régionales et les raisons sont bien différentes. En Amazonie, les chrétiens reçoivent une fois ou deux par an la visite d’un prêtre et ne peuvent pas se déplacer comme dans le Brabant wallon (Belgique) ou en Bretagne. Au Brésil, la communion au corps du Christ différencie les réunions communautaires catholiques des immenses rassemblements évangélistes ou des sectes. Ces questions ne sont donc pas ignorées ou méprisées. Ce fut d’ailleurs, à mon humble avis, un des tournants du Synode que de se centrer sur les vocations et sur les prêtres. Les réflexions et les suggestions sont classiques et vont dans le sens d’une meilleure formation des futurs « ministres » et dans une plus grande conscientisation du peuple de Dieu à cette thématique. Le nœud de la question, c’est la foi du peuple de Dieu en son Seigneur qui peut lui offrir des « pasteurs selon son cœur ». Zenit : Mais pourquoi le refus de l’ordination d’hommes mariés ? Zenit.org, 2006. Tous droits réservés - Pour connaitre les modalités d´utilisation vous pouvez consulter : www.zenit.org ou contacter infosfrench@zenit.org - Pour recevoir les news de Zenit par mail vous pouvez cliquer ici |