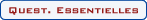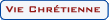30 octobre 2025 -
Bse Bienvenue Bojani
30 octobre 2025 -
Bse Bienvenue Bojani
Publié le : 12 septembre 2014 Source : Zenit.org
Les newsLe Totus tuus christocentrique et marial de Jean-Paul IILe P. François-Marie Léthel, o.c.d., secrétaire de l’Académie pontificale de théologie, fait parvenir à Zenit pour ses lecteurs cette réflexion donnée à Rocamadour le 13 août 2014, sur « Le totus tuus christocentrique et marial de Jean-Paul II et de saint Louis-Marie Grignion de Montfort ». Introduction Le Vénérable Pape Paul VI, en promulguant la Constitution Lumen Gentium, le 21 novembre 1964, insistait sur l’importance du chapitre VIII concernant la bienheureuse Vierge Marie dans le Mystère du Christ et de l’Eglise. Il le présentait comme le "sommet et couronnement" de toute cette Constitution Dogmatique sur l’Eglise. En même temps, il y mettait comme son sceau personnel en déclarant solennellement Marie Mère de l’Eglise. Ses successeurs sur la chaire de Saint Pierre ont déployé avec splendeur cette grande doctrine du Concile Vatican II, et tout particulièrement le bienheureux Jean-Paul II qui sera bientôt canonisé par notre Pape François. Jean-Paul II, qui avait participé au Concile et qui a eu ensuite la mission de guider l’Eglise au seuil du troisième Millénaire, a développé cette doctrine mariale du Concile en harmonie avec le texte d’un saint du passé qui avait profondément marqué toute sa vie : le Traité de la vraie dévotion à la sainte Vierge de saint Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716). En considérant ce Totus Tuus christocentrique et marial de Jean-Paul II et de saint Louis-Marie Grignion de Montfort, nous allons pouvoir vérifier la plus profonde continuité de la vie de l’Eglise qui est la continuité de la sainteté, sans aucune rupture entre l’Avant-Concile et l’Après-Concile. Concrètement, nous allons le voir en suivant une ligne droite marquée par trois textes, en partant du plus récent pour rejoindre le plus ancien. Ces trois textes que nous allons considérer successivement sont : I/ L’homélie de Benoît XVI pour la béatification de Jean-Paul II (1er mai 2011) ; II/ La Lettre de Jean-Paul II aux Religieux et Religieuses des Familles Montfortaines (8 décembre 2003) ; III/ Le Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge de saint Louis-Marie de Montfort. I/ L’homélie de Benoît XVI pour la béatification de Jean-Paul II (1er mai 2011) La plus belle lumière, point de départ de notre réflexion, nous est donnée par Benoît XVI dans notre premier texte, extrait de son homélie du 1er mai 2011 pour la béatification de Jean-Paul II : Chers frères et sœurs, aujourd’hui, resplendit à nos yeux, dans la pleine lumière spirituelle du Christ Ressuscité, la figure aimée et vénérée de Jean-Paul II. Aujourd’hui, son nom s’ajoute à la foule des saints et bienheureux qu’il a proclamés durant les presque 27 ans de son pontificat, rappelant avec force la vocation universelle à la dimension élevée de la vie chrétienne, à la sainteté, comme l’affirme la Constitution conciliaire Lumen gentium sur l’Église [ch V]. Tous les membres du Peuple de Dieu – évêques, prêtres, diacres, fidèles laïcs, religieux, religieuses –, nous sommes en marche vers la patrie céleste, où nous a précédé la Vierge Marie, associée de manière particulière et parfaite au mystère du Christ et de l’Église. Karol Wojtyła, d’abord comme Évêque Auxiliaire puis comme Archevêque de Cracovie, a participé au Concile Vatican II et il savait bien que consacrer à Marie le dernier chapitre du Document sur l’Église [ch VIII] signifiait placer la Mère du Rédempteur comme image et modèle de sainteté pour chaque chrétien et pour l’Église entière. Cette vision théologique est celle que le bienheureux Jean-Paul II a découverte quand il était jeune et qu’il a ensuite conservée et approfondie toute sa vie. C’est une vision qui est synthétisée dans l’icône biblique du Christ sur la croix ayant auprès de lui Marie, sa mère. Icône qui se trouve dans l’Évangile de Jean (19, 25-27) et qui est résumée dans les armoiries épiscopales puis papales de Karol Wojtyła : une croix d’or, un « M » en bas à droite, et la devise « Totus tuus », qui correspond à la célèbre expression de saint Louis Marie Grignion de Montfort, en laquelle Karol Wojtyła a trouvé un principe fondamental pour sa vie : « Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor tuum, Maria – Je suis tout à toi et tout ce qui est à moi est à toi. Je te prends pour tout mon bien. Donne-moi ton cœur, O Marie » (Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, n. 266). En lisant ce très beau texte, on est tout de suite frappé par sa clarté, sa simplicité et en même temps sa densité théologique. Fondamentalement, Benoît XVI se réfère à l’Evangile, à ce texte du chapitre 19 de saint Jean concernant la présence maternelle de Marie près de la Croix de Jésus. En relation avec ce texte de l’Evangile, il se réfère au principal document du Concile Vatican II qui est la Constitution Dogmatique sur l’Eglise Lumen Gentium, en mentionnant les deux chapitres les plus importants : le chapitre V sur la vocation universelle à la sainteté et le chapitre VIII sur Marie dans la Mystère du Christ et de l’Eglise. Enfin, il cite le texte essentiel de saint Louis-Marie de Montfort dans le Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge, son chef-d’oeuvre, qui a été le livre de chevet de Karol Wojtyła depuis l’âge de 20 ans jusqu’à sa mort. On trouve déjà ici le parfait alignement de trois textes de l’Ecriture, du Magistère et d’un Saint. - La retraite de carême pour Benoît XVI et la Curie Romaine (11-19 mars 2011) En entendant Benoît XVI prononcer ces paroles, j’ai éprouvé une immense joie. J’étais alors présent sur la place Saint Pierre avec mes confrères et mes étudiants. Ces paroles du Pape m’ont particulièrement touché parce qu’elles étaient le plus bel écho de la retraite que je venais de prêcher pour lui et ses collaborateurs de la Curie Romaine au début du carême (11-19 mars 2011). Par l’intermédiaire du Cardinal Bertone, Benoît XVI m’avait invité à donner cette retraite, en me laissant toute liberté pour le choix du thème. Tout de suite, en priant au sanctuaire marial de la Madonna del Divino Amore, j’avais compris que cette retraite devait être une préparation spirituelle à la béatification de Jean-Paul II, et qu’elle aurait comme icône la "ronde des saints" peinte par le bienheureux fra Angelico, où les saints et les anges se donnent la main et nous donnent la main. Après avoir vécu à Rome durant presque tout le pontificat de Jean-Paul II, j’avais eu la grâce de travailler ensuite pour sa béatification, ce qui m’avait fait pénétrer dans le sanctuaire le plus intérieur de son âme. Dans cette "ronde des saints", Jean-Paul II donnait d’abord la main à St Louis-Marie de Montfort inspirateur de son Totus Tuus et à Ste Thérèse de Lisieux, l’unique Docteur de l’Eglise déclaré durant son pontificat. Thérèse et Louis-Marie sont aussi les saints qui ont le plus marqué ma propre vie depuis l’année 1968, année de mes 20 ans et de ma Profession Religieuse. Ainsi, au début de la retraite, trois méditations concernaient ce rapport entre Jean-Paul II et Louis-Marie de Montfort (Med 3, 4 et 5), avant les quatre méditations sur Thérèse de Lisieux1. Le passage de l’homélie de Benoît XVI que nous venons de citer résumait merveilleusement la troisième méditation intitulée : Le Totus Tuus christocentrique et marial de Karol Wojtyła comme fil conducteur de toute sa vie. C’était pour moi un des plus beaux fruits de la retraite ! Une de mes principales intentions était précisément d’expliquer l’importance de cette doctrine à notre Pape théologien, sachant qu’il n’avait pas eu une grande familiarité avec saint Louis-Marie de Montfort. J’ai pu admirer une fois de plus son humilité, son intelligence et sa jeunesse intellectuelle comme capacité d’accueillir cet élément nouveau. Nous devons maintenant réfléchir sur son affimation concernant le Totus Tuus comme "principe fondamental" de la vie de Karol Wojtyła. - Le Totus Tuus comme "principe fondamental" de la vie de Karol Wojtyła En effet, dans la vie de Karol Wojtyla, ce Totus Tuus est devenu comme la respiration de son âme, le battement de son cœur à partir de 1940 quand il a découvert, à l’âge de 20 ans le Traité de Louis-Marie. Très souvent Jean-Paul II a raconté ce fait, comme par exemple à l’écrivain André Frossard, vers le début de son Pontificat2. Il l’a fait d’une manière spéciale au moment de son 50eanniversaire de sacerdoce, dans son livre Don et Mystère (1996). Selon son témoignage, c’est un saint laïc, Jan Tyranowski (maintenant Serviteur de Dieu) qui lui avait fait connaître le Traité de saint Louis-Marie et les Œuvres de saint Jean de la Croix, l’ouvrant ainsi à la plus profonde vie spirituelle, en ces années terribles de l’occupation nazie en Pologne. Le jeune Karol devait travailler comme ouvrier, découvrant progressivement pendant la même période sa vocation au sacerdoce. En parlant de cette période, Jean-Paul II insistait sur le « fil marial » qui avait guidé toute sa vie depuis l’enfance, dans sa famille, dans sa paroisse, par la dévotion carmélitaine au scapulaire et la dévotion salésienne à Marie Auxiliatrice (Don et Mystère, p. 41-42). La découverte du Traité l’a aidé à faire un pas décisif dans son chemin marial, en dépassant une certaine crise : Il y eut une période où je remis en cause dans une certaine mesure mon culte pour Marie, considérant que, développé excessivement, il finirait par compromettre la suprématie du culte dû au Christ. C’est alors que le livre de saint Louis-Marie Grignion de Montfort intitulé Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge fut pour moi une aide précieuse. J’y trouvai la réponse à mes doutes. Oui, Marie nous rapproche du Christ, nous conduit à Lui, à condition que l’on vive son mystère dans le Christ […]. Cet auteur est un théologien de classe. Sa pensée mariologique s’enracine dans le Mystère trinitaire et dans la vérité de l’Incarnation du Verbe de Dieu. […] Cela explique l’origine du Totus Tuus. L’expression vient de saint Louis-Marie Grignion de Montfort. C’est l’abréviation de la forme plus complète de la consécration à la Mère de Dieu qui est : Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor tuum, Maria (Don et Mystère, p. 42-43). Ces paroles en latin étaient continuellement priées et recopiées par Karol Wojtyła en tête des quatre premières pages de ses manuscrits de séminariste clandestin, prêtre, évêque et pape. Tout ceci est documenté dans la Positio de sa béatification. Ces paroles se trouvent à la fin du Traité de Louis-Marie, quand le saint invite le fidèle à vivre la Communion eucharistique avec Marie et en Marie3. Ce Totus Tuus ainsi formulé devient donc, de 1940 à 2005, la ligne directrice de toute la vie de Karol Wojtyla. Quand en 1958 il est nommé par Pie XII Évêque auxiliaire de Cracovie, il choisit déjà le Totus Tuus comme devise épiscopale, en même temps que le blason qui symbolise le Christ Rédempteur et Marie près de lui, le même qu’il conservera comme Pape. Et surtout il le vivra jusqu’à la fin, dans les grandes souffrances des derniers mois. Après la trachéotomie, quand il ne pourra plus parler, il écrira encore une dernière fois les paroles Totus Tuus4. - Accepit eam discipulus in sua (Jn 19,27) / Accipio te in mea omnia Maintenant il faut regarder attentivement ces paroles de Louis-Marie toujours reprises par Jean-Paul II. En effet, les paroles Accipio Te in mea omnia (« Je te prends pour tout mon bien ») sont l’appropriation personnelle du texte de l’Évangile : Accepit eam discipulus in sua (« Le disciple la prit chez lui » ; Jn 19,27). Marie est un don que le disciple reçoit continuellement de Jésus lui-même et qu’il accueille dans le don de soi exprimé par les paroles Totus tuus sum ego (« Je suis tout à toi »). Louis-Marie le dit en parlant à Jésus, en s’identifiant avec le disciple saint Jean : "Je l’ai mille et mille fois prise pour tout mon bien avec saint Jean l’Évangéliste, au pied de la croix et je me suis autant de fois donné à elle ; mais, si je ne l’ai pas encore bien fait selon vos désirs, mon cher Jésus, je le fais maintenant comme vous le voulez que je fasse" (SM 66). D’une manière extrêmement synthétique Louis-Marie exprime ici une des grandes lois de la vie spirituelle : la nécessité du don de soi pour accueillir le Don de Dieu5. C’est seulement dans le don total de soi, exprimé par le Totus Tuus, que le disciple peut accueillir le Don de Dieu : le don du Père qui donne son Fils et l’Esprit de son Fils (cf Ga 4,4-6), le don du Fils qui se donne lui-même, qui donne l’Esprit, qui donne sa Mère, et aussi le don de Marie qui donne son Fils et qui se donne elle-même. En effet, c’est Jésus qui a donné son disciple à sa Mère : « Voici ton Fils », et la Mère à son disciple : « Voici ta Mère » (Jn 19,26-27). Le Verbe incarné et Rédempteur, avec sa parole toute puissante a créé une nouvelle relation entre Marie et le disciple, une relation d’amour dans le don réciproque de soi. Louis-Marie le dit d’une manière splendide, en citant toujours le même texte de l’Évangile en latin : La Très Sainte Vierge, qui est une mère de douceur et de miséricorde, et qui ne se laisse jamais vaincre en amour et en libéralité, voyant qu’on se donne tout entier à elle pour l’honorer et la servir, en se dépouillant de ce qu’on a de plus cher pour l’en orner, se donne aussi tout entière et d’une manière ineffable à celui qui lui donne tout. Elle le fait s’engloutir dans l’abîme de ses grâces ; elle l’orne de ses mérites ; elle l’appuie de sa puissance ; elle l’éclaire de sa lumière ; elle l’embrase de son amour ; elle lui communique ses vertus : son humilité, sa foi, sa pureté, etc. ; elle se rend sa caution, son supplément et son tout envers Jésus. Enfin, comme cette personne consacrée est toute à Marie, Marie est aussi toute à elle ; en sorte qu’on peut dire de ce parfait serviteur et enfant de Marie ce que saint Jean l’Évangéliste dit de lui même, qu’il a pris la Très Sainte Vierge pour tous ses biens : Accepit eam discipulus in sua6. Mais ce don de Marie vient toujours de Jésus et conduit toujours à Jésus. C’est le sens de la demande Praebe mihi Cor Tuum, Maria (« Donne-moi ton Cœur, ô Marie »). Il ne s’agit pas principalement d’aimer Marie, mais plutôt d’aimer Jésus avec le Cœur de Marie, et en Lui d’aimer le Père et l’Esprit Saint, l’Église et tous les hommes. La personne qui exprime et qui vit le Totus Tuus, vit et exprime en même temps le Totus Meus : le Christ est tout à moi, et Marie aussi est toute à moi (Tota Mea). C’étaient exactement les paroles de saint Jean de la Croix dans sa prière de l’âme embrasée d’amour : « La Mère de Dieu est à moi… Dieu lui-même est à moi et pour moi, parce que le Christ est à moi et tout entier pour moi » (Paroles de Lumière et d’Amour, n. 26). II/ La Lettre de Jean-Paul II aux Religieux et Religieuses des Familles Montfortaines (8 décembre 2003) Dans les textes de son magistère, Jean-Paul II s’est référé souvent à saint Louis-Marie, comme par exemple dans l’Encyclique Redemptoris Mater (n. 48). Mais, d’une manière particulière, vers la fin de son pontificat il nous a laissé une très belle synthèse de sa doctrine interprétée à la lumière du Concile Vatican II, dans sa Lettre aux Religieux et Religieuses des Familles Montfortaines du 8 décembre 20037. Dans l’introduction de cette Lettre (n. 1), Jean-Paul II présente le Traité de Louis-Marie comme un texte classique de la spiritualité mariale, qui a eu une extraordinaire réception ecclésiale et qu’on peut comprendre encore mieux après le Concile. La Lettre Pontificale cite continuellement les textes de Lumen Gentium, du Traité de la vraie dévotion, et du Secret de Marie qui le résume. Après cette introduction qui contient la citation du texte fondamental de l’Evangile (Jn 19,25-27), on peut distinguer deux parties qui correspondent exactement aux chapitres VIII et V de Lumen Gentium et aux deux parties du Traité de la Vraie Dévotion. Dans la première partie, à la lumière du chapitre VIII de Lumen Gentium sur la bienheureuse Vierge Marie dans le mystère du Christ et de l’Église, Jean-Paul II considère d’abord l’aspect christologique de la doctrine montfortaine sous le titre : « Ad Jesum per Mariam » (n. 2-4) et ensuite son aspect ecclésiologique sous le titre : Marie, membre éminent du Corps mystique et Mère de l’Église (n. 5). Cela correspond exactement à la première partie du Traité de la Vraie Dévotion (VD 1-89). La deuxième partie du texte de Jean-Paul II se situe plutôt dans la perspective du chapitre V de Lumen Gentium sur la vocation universelle à la sainteté, en montrant le chemin ecclésial de la sainteté vécu avec Marie dans la charité, la foi et l’espérance. Ainsi les trois derniers points sont intitulés : La sainteté, perfection de la charité (n. 6), Le « pèlerinage de la foi » (n. 7) et Signe d’espérance assurée (n. 8), en citant toujours les textes du Concile et de Louis-Marie. Cela correspond à la deuxième partie du Traité (VD 90-273). Ce texte de Jean-Paul II est donc la meilleure introduction à la lecture du Traité, pour montrer sa profonde harmonie avec l’enseignement du Concile8, et c’est aussi une des meilleures clefs pour entrer dans la profondeur de l’âme de Jean-Paul II, pour comprendre le sens de toute sa vie vécue en union profonde avec Marie dans le Mystère du Christ et de l’Eglise, en partageant sa foi, son espérance et son amour. A/ Marie dans le Mystère du Christ et de l’Eglise - "Ad Iesum per Mariam : La vraie dévotion à Marie est christocentrique (n. 2-4) « La vraie dévotion à Marie est christocentrique », affirme Jean-Paul II dans sa Lettre sous le titre Ad Jesum per Mariam, et cette grande affirmation est aussitôt illustrée par les textes du Concile et de Louis-Marie. On y trouve la même insistance sur le christocentrisme comme la première des « vérités fondamentales » de la vraie dévotion à Marie (VD 61-67), c’est-à-dire l’absolu et la centralité du Christ et la totale relativité de Marie à Lui et à la Sainte Trinité : L’amour pour Dieu à travers l’union à Jésus Christ est la finalité de toute dévotion authentique, car - comme l’écrit saint Louis-Marie - le Christ "est notre unique maître qui doit nous enseigner, notre unique Seigneur de qui nous devons dépendre, notre unique chef auquel nous devons être unis, notre unique modèle auquel nous devons nous conformer, notre unique médecin qui doit nous guérir, notre unique pasteur qui doit nous nourrir, notre unique voie qui doit nous conduire, notre unique vérité que nous devons croire, notre unique vie qui doit nous vivifier et notre unique tout en toutes choses qui doit nous suffire" (VD 61). La dévotion à la Sainte Vierge est un moyen privilégié "pour trouver Jésus Christ parfaitement et l’aimer tendrement et le servir fidèlement" (VD 62). Ce désir central d’"aimer tendrement" est immédiatement amplifié en une prière ardente à Jésus, lui demandant la grâce de participer à l’indicible communion d’amour qui existe entre Lui et sa Mère.La totale relativité de Marie au Christ, et en Lui à la Très Sainte Trinité, apparaît tout d’abord dans l’observation suivante : "Enfin, parce que vous ne pensez jamais à Marie, que Marie, en votre place, ne pense à Dieu ; vous ne louez ni n’honorez jamais Marie, que Marie avec vous ne loue et n’honore Dieu. Marie est toute relative à Dieu et je l’appellerais fort bien la relation de Dieu, qui n’est que par rapport à Dieu, ou l’écho de Dieu, qui ne dit et ne répète que Dieu. Si vous dites Marie, elle dit Dieu. Sainte Elisabeth loua Marie et l’appela bienheureuse de ce qu’elle avait cru ; Marie, l’écho fidèle de Dieu, entonna : Magnificat anima mea Dominum : Mon âme glorifie le Seigneur. Ce que Marie a fait en cette occasion, elle le fait tous les jours ; quand on la loue, on l’aime, on l’honore ou on lui donne, Dieu est loué, Dieu est aimé, Dieu est honoré, on donne à Dieu par Marie et en Marie" (VD 225).C’est encore dans la prière à la Mère du Seigneur que saint Louis-Marie exprime la dimension trinitaire de sa relation avec Dieu : "Je vous salue Marie, Fille bien-aimée du Père Éternel ; je vous salue, Marie, Mère admirable du Fils ; je vous salue, Marie, Épouse très fidèle du Saint Esprit ! (SM 68). (LFM, n. 2-3). Tout le long Pontificat de Jean-Paul II illuminé par le Totus Tuus, a donné une éclatante démonstration de cette vérité fondamentale, à partir de la première encyclique Redemptor Hominis qui commence avec les mots : « Le Rédempteur de l’Homme, Jésus Christ est le centre du Cosmos et de l’Histoire ». Le disciple qui reçoit de Jésus lui-même le don de Marie à travers le don total de lui-même entre par elle dans le Mystère de l’Alliance, dans la profondeur de l’admirable échange entre Dieu et l’homme dans le Christ Jésus. « Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu », disaient les Pères de l’Église. Le Fils de Dieu est descendu du Ciel et s’est incarné par l’opération du Saint-Esprit dans le sein virginal de Marie, pour nous faire monter avec lui dans le sein du Père. Marie occupe exactement la même place dans le mouvement « descendant » de l’Incarnation et dans le mouvement « ascendant » de notre divinisation. - Marie, membre éminent du Corps mystique et Mère de l’Église (n. 5) La place de Marie dans le Mystère de l’Église est la conséquence de sa place fondamentale dans le Mystère du Christ, comme Theotokos, Mère de Dieu. Sur la base de l’Écriture et de la grande Tradition des Pères de l’Église et des Saints, le Concile a particulièrement mis en lumière ce rapport essentiel entre Marie et l’Église. Le Vénérable Paul VI a beaucoup insisté sur ce point dans son grand discours au Concile du 21 novembre 1964, au moment de la promulgation de Lumen Gentium, quand il a donné solennellement à Marie le titre de Mère de l’Église. Dix ans plus tard, dans Marialis Cultus, le même Paul VI donnait une des plus belles expressions de la spiritualité du Concile, en affirmant que « l’amour pour l’Église se traduira en amour pour Marie, et réciproquement : parce que l’une ne peut subsister sans l’autre » (n. 28). Le rapport entre Marie et l’Église est tellement intime qu’il n’est pas possible d’aimer Marie sans aimer l’Église, ni d’aimer l’Église sans aimer Marie ! Cette doctrine du Concile et de Paul VI est résumée par Jean-Paul II au n. 5 de sa Lettre aux Familles Monfortaines sous le titre : Marie, membre éminent du Corps mystique et Mère de l’Église, en citant toujours les textes du Concile et de Louis-Marie. On y retrouve la doctrine classique du Corps mystique, fondée sur l’enseignement de saint Paul. Le Christ est la Tête et nous sommes ses membres, et c’est toujours l’Esprit Saint qui forme le Corps du Christ dans la Tête et dans les membres. Marie ne peut être la Mère de la Tête sans être la Mère des membres, c’est-à-dire elle ne peut être Mère du Christ sans être Mère de l’Église, toujours par l’action de l’Esprit Saint. Grâce à la nouvelle naissance du baptême, l’Esprit Saint nous a incorporés au Christ, et son œuvre de sanctification est de rendre chaque membre toujours plus ressemblant à la Tête qui est le Christ. Mais en même temps que cet aspect de Marie Mère du Corps du Christ qui est l’Église, le Concile a davantage développé l’autre aspect de Marie comme Image parfaite de l’Église, c’est-à-dire de l’identification entre Marie et l’Église. De ce point de vue, l’œuvre sanctificatrice de l’Esprit Saint nous rend toujours plus semblables à Marie, Vierge et Mère, humble Servante du Seigneur, en partageant sa foi, son espérance et sa charité. Nous devons toujours rappeler que l’âme de la spiritualité de Louis-Marie est le Totus Tuus comme continuel acte de charité. Tel est le sens de sa « parfaite dévotion », qui n’est pas une des nombreuses dévotions à Marie (même si elle les inclut toutes, comme par exemple celle du Rosaire), mais la vie baptismale vécue avec Marie et en Marie. Elle est essentiellement « pratique intérieure », vie intérieure, chemin de vie spirituelle profonde qui doit conduire progressivement à la sainteté, exactement comme l’itinéraire décrit par sainte Thérèse d’Avila à travers les « sept demeures » du Château Intérieur. Ce sont les étapes du cheminement spirituel comme passage de la superficialité à la profondeur, de l’extériorité à l’intériorité9. Il n’y a pas de doute que Jean-Paul II a vécu cette spiritualité christocentrique et mariale au niveau le plus élevé de la vie mystique qui est l’union transformante. Ainsi dans ce développement ecclésiologique de sa Lettre, il met en évidence cette « identification mystique avec Marie » qui est « tout entière tournée vers Jésus » : L’une des expressions les plus élevées de la spiritualité de saint Louis-Marie Grignion de Montfort se réfère à l’identification du fidèle avec Marie dans son amour pour Jésus, dans son service de Jésus. En méditant le célèbre texte de saint Ambroise : Que l’âme de Marie soit en chacun pour glorifier le Seigneur, que l’esprit de Marie soit en chacun pour exulter en Dieu (Expos. in Luc 12, 26 : PL 15, 1561), il écrit : "Qu’une âme est heureuse quand... elle est toute possédée et gouvernée par l’esprit de Marie, qui est un esprit doux et fort, zélé et prudent, humble et courageux, pur et fécond !" (VD 258). L’identification mystique avec Marie est entièrement tournée vers Jésus, comme il l’exprime dans la prière : "Enfin, ma très chère et bien-aimée Mère, faites, s’il se peut, que je n’aie point d’autre esprit que le vôtre pour connaître Jésus et ses divines volontés ; que je n’aie point d’autre âme que la vôtre pour louer et glorifier le Seigneur ; que je n’aie point d’autre cœur que le vôtre pour aimer Dieu d’un amour pur et d’un amour ardent comme vous" (SM 68) (LFM, n. 5). Le texte du Traité cité ici s’applique parfaitement à Jean-Paul II. Le Pape marial a été un homme doux et fort, zélé et prudent, humble et courageux, pur et fécond. La demande Praebe mihi Cor Tuum, o Maria a été exaucée. Le même Louis-Marie qui avait la merveilleuse expérience de cette identification mystique avec Marie espérait que cette doctrine porterait beaucoup de fruit dans les siècles suivants de l’Église10. La doctrine montfortaine met bien en lumière l’aspect christologique et l’aspect pneumatologique de la vraie dévotion à Marie. Marie ne prend jamais la place de Jésus ni de l’Esprit Saint, mais elle est toute relative à Jésus et à l’Esprit, Mère de Jésus et Épouse de l’Esprit, c’est-à-dire toujours dans les « deux Mains du Père », selon la belle expression symbolique de saint Irénée. C’est toujours l’Esprit Saint qui agit en Marie pour former le Corps du Christ, dans la Tête et dans les membres, et aussi pour « reproduire » Marie elle-même dans l’Église, dans les âmes, c’est-à-dire en chacune des personnes dans l’Église. Sur ce point, la doctrine de Louis-Marie s’harmonise parfaitement avec l’enseignement du Concile sur Marie comme image et exemplaire parfait de la Sainte Église (cf Lumen Gentium nn. 63-65). Il s’agit donc de se laisser modeler par l’Esprit Saint pour être configuré à Jésus comme le membre à son Chef, et aussi pour être configuré à Marie comme à la Vierge Mère qui l’aime parfaitement, l’enfante et le fait aimer. B/ Le chemin ecclésial de la sainteté vécu avec Marie dans la foi, l’espérance et la charité Jésus Rédempteur de l’homme a donné Marie pour Mère à son disciple, à toute l’Église, à chacun d’entre nous, à toute l’humanité, à tout homme. Selon les paroles de Jean-Paul II au début de sa Lettre aux Familles Monfortaines, telle est l’expérience de l’Église "depuis les origines, et spécialement dans les moments les plus difficiles" : Au cours de son histoire, le Peuple de Dieu a fait l’expérience de ce don fait par Jésus crucifié : le don de sa Mère. La Très Sainte Vierge est véritablement notre Mère, qui nous accompagne dans notre pèlerinage de foi, d’espérance et de charité vers l’union toujours plus intense avec le Christ, l’unique sauveur et médiateur du salut (cf. Const. Lumen gentium, nn. 60 et 62) (LFM, n. 1). Comme toujours, le Pape se réfère au Concile. De la même manière, saint Jean de la Croix enseigne que seules, la foi, l’espérance et la charité sont les moyens de l’union à Dieu en Jésus-Christ (La Montée du Carmel). Ce sont les plus grands dons de l’Esprit Saint que tous nous avons reçus dans la grâce du Baptême. C’est le vêtement baptismal que le Docteur Mystique décrit symboliquement avec les trois couleurs : blanc de la foi, vert de l’espérance, rouge de la charité, qui est aussi l’armure de Dieu décrite par saint Paul et qui nous rendra toujours victorieux dans les combats les plus durs (cf Nuit Obscure, II, ch. 21). Et c’est la même grâce du baptême que Louis-Marie nous invite à vivre pleinement avec Marie et en Marie. Les Œuvres de saint Jean de la Croix et le Traité de saint Louis-Marie, que le jeune Karol Wojtyla avait reçues de Jan Tyranowski, était un authentique manuel de combat spirituel, enseignant à utiliser continuellement ces armes invincibles et toujours victorieuses de la foi, l’espérance et la charité. C’est le niveau le plus profond et le plus simple de l’identification mystique avec Marie, opérée par l’Esprit Saint qui veut faire de nous des copies vivantes de Marie pour aimer et glorifier Jésus-Christ (VD 217). Ainsi, la foi, l’espérance et la charité sont les plus grands trésors que Marie comme Mère partage avec l’Église en pèlerinage, et avec chacun de ses enfants. C’est proprement "le trésor de la Mère qui appartient à l’enfant" selon l’expression de sainte Thérèse de Lisieux (PN 54, str 5). En présentant les "effets merveilleux" (VD 213-225) de cette "parfaite dévotion", Louis-Marie nous montre comment la personne qui vit pleinement le Totus Tuus chemine avec Marie sur le chemin de l’humilité évangélique, qui est la voie de l’amour, de la foi et de l’espérance. Rappelons toujours que le Totus Tuus n’est rien d’autre que l’acte de la charité : "Jésus je t’aime" / "Je suis tout à toi". Ainsi, à la fin de sa Lettre aux familles montfortaines, Jean-Paul II synthétise cet enseignement du Traité, toujours à la lumière de Lumen Gentium, considérant successivement la charité, la foi et l’espérance, avec les trois sous-titres très significatifs : La sainteté, perfection de la charité ; le ‘pèlerinage de la foi’ ; signe de l’espérance assuré. Maintenant, avec la reconnaissance des vertus héroïques de Jean-Paul II, sa béatification et sa canonisation, ce texte devient une excellente clef d’interprétation de sa vie comme chemin de sainteté, c’est-à-dire de charité, foi et espérance vécues avec Marie et en Marie. - La sainteté, perfection de la charité (n. 6) D’abord, au sujet de la sainteté, perfection de la charité, Jean-Paul II écrit, en citant toujours les textes du Concile et de Louis-Marie : La ConstitutionLumen Gentium ajoute encore : "Cependant, si l’Eglise, en la personne de la bienheureuse Vierge, atteint déjà à la perfection qui la fait sans tache ni ride (cf. Ep 5, 27), les fidèles du Christ, eux, sont encore tendus dans leur effort pour croître en sainteté par la victoire sur le péché : c’est pourquoi ils lèvent les yeux vers Marie comme modèle des vertus qui rayonne sur toute la communauté des élus" (n. 65). La sainteté est la perfection de la charité, de cet amour pour Dieu et pour le prochain qui est l’objet du plus grand commandement de Jésus (cf. Mt 22, 38), et qui est également le plus grand don de l’Esprit Saint (cf. 1 Co 13, 13). Ainsi, dans ses Cantiques, saint Louis-Marie présente successivement aux fidèles l’excellence de la charité (Cantique 5), la lumière de la foi (Cantique 6) et la fermeté de l’espérance (Cantique 7). (LFM, n. 6). A propos de la charité, Jean-Paul II ne craint pas de reprendre et de justifier l’expression paradoxale de l’esclavage d’amour, en citant et en commentant un des textes les plus éclairant de Louis-Marie sur ce point : Dans la spiritualité montfortaine, le dynamisme de la charité est en particulier exprimé à travers le symbole de l’esclavage d’amour de Jésus sur l’exemple de Marie et avec son aide maternelle. Il s’agit de la pleine communion à la kénosis du Christ ; une communion vécue avec Marie, intimement présente dans les mystères de la vie du Fils. "Il n’y a rien aussi parmi les chrétiens qui nous fasse plus absolument appartenir à Jésus Christ et à sa sainte Mère que l’esclavage de volonté, selon l’exemple de Jésus Christ même, qui a pris la forme d’esclave pour notre amour : formam servi accipiens, et de la Sainte Vierge, qui s’est dite la servante et l’esclave du Seigneur. L’Apôtre s’appelle par honneur servus Christi. Les Chrétiens sont appelés plusieurs fois dans l’Ecriture sainte servi Christ" (Traité de la vraie dévotion, n. 72). En effet, le Fils de Dieu, venu au monde en obéissance au Père dans l’Incarnation (cf. He 10, 7), s’est ensuite humilié en se faisant obéissant jusqu’à la mort et à la mort sur une Croix (cf. Ph 2, 7-8). Marie a répondu à la volonté de Dieu par le don total d’elle-même, corps et âme, pour toujours, de l’Annonciation à la Croix, et de la Croix à l’Assomption. (…) L’esclavage d’amour doit donc être interprété à la lumière de l’admirable échange entre Dieu et l’humanité dans le mystère du Verbe incarné. Il s’agit d’un véritable échange d’amour entre Dieu et sa créature dans la réciprocité du don total de soi. "L’esprit de cette dévotion... est de rendre une âme intérieurement dépendante et esclave de la Très Sainte Vierge et de Jésus par elle" (Secret de Marie, n. 44). Paradoxalement, ce "lien de charité", cet "esclavage d’amour", rend l’homme pleinement libre, en lui conférant la véritable liberté des enfants de Dieu (cf. Traité de la vraie dévotion, n. 169). Il s’agit de se remettre totalement à Jésus, en répondant à l’Amour avec lequel Il nous a aimés le premier. Quiconque vit dans cet amour, peut dire comme saint Paul : "Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi (Gal 2, 20)". (ibid). C’est une explication lumineuse, à partir des textes de l’Évangile et de saint Paul cités ici par saint Louis-Marie. On y perçoit la résonance des mots "serviteur", "esclave" (c’est le même mot doulos en grec, servus en latin) : Jésus dans la condition d’esclave, Marie servante du Seigneur, Paul serviteur ou esclave du Christ. On comprend alors clairement que l’esclavage d’amour signifie la folie de l’amour, la radicalité de l’amour comme don total, absolu, sans réserve et sans limite, l’amour vécu par Jésus, par Marie et par les saints, comme nous sommes nous aussi appelés à vivre. C’est l’Amour qui se révèle dans les Mystères de l’Incarnation et de la Rédemption. C’est l’Amour qui s’exprime dans le Totus Tuus comme don total de soi à Jésus, et en Lui à Dieu et aux hommes. Telle a été la charité de Jean-Paul II comme unique amour de Jésus Rédempteur de l’homme et de l’homme racheté par Lui, un immense amour continuellement vécu dans la rencontre avec Jésus et dans la rencontre avec l’homme. Comme saint Paul, le Pape a été inséparablement un grand mystique et un grand apôtre, homme de prière et pasteur infatigable. - Le pèlerinage de la foi (n. 7) Sous ce titre le ‘pèlerinage de la foi’, Jean-Paul II synthétise l’enseignement du Concile et de Louis-Marie sur la "foi de Marie mystérieusement partagée par l’Église". D’abord, nous trouvons des références à Lumen Gentium et à ses deux Lettres Redemptoris Mater et Novo Millennio Ineunte : J’ai écrit dans Novo millennio ineunte qu’"on ne parvient véritablement à Jésus que par la voie de la foi" (n. 19). Ce fut précisément la voie suivie par Marie au cours de toute sa vie terrestre, et c’est la voie de l’Eglise en pèlerinage jusqu’à la fin des temps. Le Concile Vatican II a beaucoup insisté sur la foi de Marie, mystérieusement partagée par l’Eglise, en mettant en lumière l’itinéraire de Notre-Dame à partir du moment de l’Annonciation jusqu’au moment de la Passion rédemptrice (cf. Const. Lumen Gentium, n. 57 et 67 ; Lettre enc. Redemptoris Mater, nn. 25-27). (LFM, n. 7). Il s’agit toujours de la foi christocentrique, foi en Jésus Rédempteur de l’homme, comme caractéristique essentielle de la vie sur la terre comme voie, pèlerinage, le même pèlerinage de Marie, de l’Église et de chacun de nous. La même vérité est aussitôt illustrée par une longue citation du Traité (la plus longue dans la Lettre) qui est comme un "hymne à la foi" de Marie, vécue ensuite par l’Église en pèlerinage. Dans les écrits de saint Louis-Marie, nous trouvons le même accent sur la foi vécue par la Mère de Jésus sur un chemin qui se déroule de l’Incarnation à la Croix, une foi dans laquelle Marie est le modèle et le type de l’Eglise. Saint Louis-Marie l’exprime avec une grande richesse de nuances lorsqu’il expose à son lecteur les "effets merveilleux" de la parfaite dévotion mariale : ’Plus donc vous gagnerez la bienveillance de cette auguste Princesse et Vierge fidèle, plus vous aurez de pure foi dans toute votre conduite : une foi pure, qui fera que vous ne vous soucierez guère du sensible et de l’extraordinaire ; une foi vive et animée par la charité, qui fera que vous ne ferez vos actions que par le motif du pur amour ; une foi ferme et inébranlable comme un rocher, qui fera que vous demeurerez fermes et constants au milieu des orages et des tourmentes ; une foi agissante et perçante, qui, comme un mystérieux passe-partout, vous donnera entrée dans tous les mystères de Jésus Christ, dans les fins dernières de l’homme et dans le cœur de Dieu même ; une foi courageuse, qui vous fera entreprendre et venir à bout de grandes choses pour Dieu et le salut des âmes, sans hésiter ; enfin, une foi qui sera votre flambeau enflammé, votre vie divine, votre trésor caché de la divine Sagesse, et votre arme toute-puissante dont vous vous servirez pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et l’ombre de la mort, pour embraser ceux qui sont tièdes et qui ont besoin de l’or embrasé de la charité, pour donner la vie à ceux qui sont morts par le péché, pour toucher et renverser, par vos paroles douces et puissantes, les cœurs de marbre et les cèdres du Liban, et enfin pour résister au diable et à tous les ennemis du salut’ (Traité de la vraie dévotion, n. 214) (Ibid.) Ce splendide "hymne à la foi" (cf He 11) met en évidence "la foi vive animée par la charité", qui est inséparablement contemplative et apostolique. En se référant à saint Jean de la Croix, maître de la vie spirituelle, Jean-Paul II insiste spécialement sur la dimension contemplative de la "foi pure" vécue avec Marie dans l’obscurité, jusqu’au moment culminant de la Passion de Jésus : Comme saint Jean de la Croix, saint Louis-Marie insiste surtout sur la pureté de la foi et sur son obscurité essentielle et souvent douloureuse (cf. Secret de Marie, nn. 51-52). C’est la foi contemplative qui, renonçant aux choses sensibles ou extraordinaires, pénètre dans les profondeurs mystérieuses du Christ. Ainsi, dans sa prière, saint Louis-Marie s’adresse à la Mère du Seigneur en disant : "Je ne vous demande ni visions, ni révélations, ni goûts, ni plaisirs même spirituels... Pour ma part, ici-bas, je n’en veux point d’autre que celle que vous avez eue, savoir : de croire purement, sans rien goûter ni voir" (ibid., n. 69). La Croix est le moment culminant de la foi de Marie, comme je l’ai écrit dans l’Encyclique Redemptoris Mater : "Par une telle foi Marie est unie parfaitement au Christ dans son dépouillement... C’est là sans doute, la kénose de la foi la plus profonde dans l’histoire de l’humanité" (n. 18) (ibid). Dans Redemptoris Mater citée ici, le Pape avait écrit une longue et splendide méditation sur la foi de Marie (nn. 12-19), à la lumière des paroles de l’Évangile : "Bienheureuse celle qui a cru" (Lc 1,45), et en référence à l’enseignement du Concile sur ce "pèlerinage de la foi" (Lumen Gentium, n. 58). La forte expression de kenose de la foi signifie, non certes l’écroulement ou la perte de la foi, mais au contraire la foi la plus héroïque au moment de la plus grande épreuve, dans les ténèbres du Calvaire. Cet aspect de l’épreuve de la foi est très fort dans l’Église moderne, en contact avec les autres religions, et aussi avec l’athéisme. Nous le voyons spécialement chez sainte Thérèse de Lisieux, dans la dernière période de sa vie. Une telle épreuve de la foi a été intensément par deux grandes mystiques très proches de Jean-Paul II : la bienheureuse Teresa de Calcutta et Chiara Lubich. Thérèse de Lisieux avait conscience de vivre sa dramatique "épreuve contre la foi" pour le salut de ses "frères" athées (cf Manuscrit C, 5v-7v), voyant en Marie l’exemple de la personne "qui cherche Jésus dans la nuit de la foi" (PN 54/15). Selon les paroles de Louis-Marie citées par Jean-Paul II, cette foi pure, tellement obscure, ne demande à Marie ni "visions ni révélations", mais au contraire demande de "croire sans rien goûter ni voir". C’est la même doctrine de Jean de la Croix vécue par Thérèse de Lisieux, qu’il faut rappeler aujourd’hui à tant de fidèles dont la dévotion mariale est trop liée à des apparitions, visions et à révélations non reconnues par l’Eglise. Plus que jamais il faut rappeler l’enseignement du Concile sur la "vraie dévotion" à Marie qui "procède de la vraie foi" (cf Lumen Gentium, n. 67). Sur ce point aussi est important le critère de la raison (saint Jean de la Croix en parle souvent), c’est-à-dire de la vraie raison, de la "grande raison" (non pas la "petite" du rationalisme). Les vraies apparitions approuvées par l’Église, comme les vraies grâces mystiques, n’ont jamais le caractère irrationnel des fausses. Avec son blason qui symbolise Jésus Crucifié et Marie près de lui, Jean-Paul II indique comme centre de notre foi la Personne de Jésus Rédempteur de l’homme. En effet, l’Encyclique inaugurale Redemptor Hominis, qui a illuminé tout le pontificat de Jean-Paul II, commence avec ce formidable acte de foi : "Le Rédempteur de l’homme, Jésus-Christ, est le centre du cosmos et de l’histoire". Ainsi le successeur de Pierre renouvelle l’acte de foi de l’Apôtre, disant à Jésus : "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant" (Mt, 16, 16). Et c’est sur la base de cette confession de foi que Jésus a fondé pour toujours son Église. "Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les puissances de l’enfer ne prévaudront pas sur elle" (ibid, 18). Au moment de la Passion, Jésus a prié d’une manière spéciale pour Pierre, "pour que sa foi ne défaille pas", en lui donnant la mission de "confirmer ses frères" (cf Lc 22,31-32). Après le triple reniement de Pierre, Jésus Ressuscité le rétablira dans sa mission de Pasteur de son peuple par son triple acte d’Amour : "M’aimes-tu ? Tu sais que je t’aime" (Jn 21,15-19). C’est la même foi en Jésus-Christ, vécue par Pierre, Paul et les autres Apôtres, qui a été vécu e d’une manière encore plus profonde et absolument parfaite par Marie, Sainte et Immaculée. - Signe d’espérance assurée (n. 8) Jean-Paul II termine sa Lettre aux Familles montfortaines en contemplant Marie comme Signe d’espérance assurée. Ce dernier titre de la Lettre reprend une expression utilisée par le Concile, à la fin de Lumen Gentium. Le texte est cité en relation avec la doctrine du Traité : L’Esprit Saint invite Marie à "se reproduire" dans ses élus, en développant en eux les racines de sa "foi invincible", mais également de sa "ferme espérance" (cf. VD, n. 34). C’est ce qu’a rappelé le Concile Vatican II : "Cependant, tout comme dans le ciel où elle est déjà glorifiée corps et âme, la Mère de Jésus représente et inaugure l’Église en son achèvement dans le siècle futur, de même sur cette terre, en attendant la venue du jour du Seigneur, elle brille déjà comme un signe d’espérance assurée et de consolation devant le Peuple de Dieu en pèlerinage" (Const. Lumen gentium, n. 68). Cette dimension eschatologique est contemplée par saint Louis-Marie, en particulier lorsqu’il parle des "saints des derniers temps", formés par la Sainte Vierge afin d’apporter dans l’Église la victoire du Christ sur les forces du mal (cf. VD, nn. 49-59). Il ne s’agit en aucune façon d’une forme de "millénarisme", mais du sens profond du caractère eschatologique de l’Église, liée à l’unicité et à l’universalité salvifique de Jésus Christ. L’Église attend la venue glorieuse de Jésus à la fin des temps. Comme Marie et avec Marie, les saints sont dans l’Église et pour l’Église, afin de faire resplendir sa sainteté, afin d’étendre jusqu’aux extrémités de la terre et jusqu’à la fin des temps l’œuvre du Christ, unique Sauveur (LFM, n. 8). Ici, le Pape se réfère sûrement à la déclaration Dominus Iesus ("l’unicité et l’universalité salvifique de Jésus-Christ") et au chapitre VII de Lumen Gentium sur le Caractère eschatologique de l’Église en pèlerinage et son union avec l’Église du ciel. Comme profond connaisseur de l’enseignement du Concile et de la doctrine de Louis-Marie, Jean-Paul II nous offre la meilleure clef pour la juste interprétation de cette section du Traité sur les saints des derniers temps, en écartant toute accusation de "millénarisme". Au contraire, c’est une doctrine très belle sur Marie et l’Église, et sur le rôle privilégié des saints dans l’Église, et cela dans la perspective dynamique de l’histoire du salut. Puis Jean-Paul II cite un des textes les plus beaux du Traité au concernant l’espérance vécue avec Marie. En référence à la Lettre aux Hébreux, "l’espérance assurée" est symbolisée par l’ancre ferme (He 6,19), un des symboles les plus chers aux premiers chrétiens : Dans l’antienne Salve Regina, l’Église appelle la Mère de Dieu "notre Espérance". La même expression est utilisée par saint Louis-Marie, à partir d’un texte de saint Jean Damascène, qui applique à Marie le symbole biblique de l’ancre (cf. Hom. Ia in Dorm. B.V. M., 14 : PG 96, 719) : "Nous attachons les âmes à votre espérance comme à une ancre ferme. C’est à elle que les saints qui se sont sauvés se sont le plus attachés et ont attaché les autres, afin de persévérer dans la vertu. Heureux donc et mille fois heureux les chrétiens qui, maintenant, s’attachent fidèlement et entièrement à elle comme à une ancre ferme" (Vraie Dévotion, n. 175). A travers la dévotion à Marie, Jésus lui-même "élargit le cœur par une sainte confiance en Dieu, le faisant regarder comme son père ; il lui inspire un amour tendre et filial" (ibid., n. 169) (LFM, n. 8). La même espérance est confiance en la Miséricorde Divine pour le salut du monde, une espérance sans limite pour soi-même et pour les autres jusqu’à être espérance pour tous. Telles sont les affirmations très fortes du Pape, inspirées par la doctrine de Thérèse de Lisieux et par les dernières paroles de Lumen Gentium, qui sont aussi les dernières de sa Lettre : Avec la Sainte Vierge, avec le même cœur de Mère, l’Église prie, espère et intercède pour le salut de tous les hommes. Ce sont les dernières paroles de la Constitution Lumen Gentium : "Que tous les chrétiens adressent à la Mère de Dieu et des hommes d’instantes supplications, afin qu’après avoir assisté de ses prières l’Église naissante, maintenant encore, exaltée dans le ciel au-dessus de tous les bienheureux et des anges, elle continue d’intercéder près de son Fils dans la communion de tous les saints, jusqu’à ce que toutes les familles des peuples, qu’ils soient déjà marqués du beau nom de chrétiens ou qu’ils ignorent encore leur Sauveur, soient enfin heureusement rassemblées dans la paix et la concorde en un seul Peuple de Dieu à la gloire de la Très Sainte et indivisible Trinité" (n. 69) (ibid). Le Pape marial a été d’une manière exemplaire l’homme de l’espérance. Sur ce point il est particulièrement proche de Thérèse de Lisieux qui est par excellence le Docteur de la Miséricorde et de l’Espérance, c’est-à-dire de l’Espérance illimitée en la Miséricorde Infinie du Rédempteur. Telle était donc l’espérance de Jean-Paul II, vécue dans le cœur maternel de Marie et de l’Église, un cœur qui embrasse tous les hommes, et chacun, d’une manière unique11. De la même manière le Pape Benoît XVI a conclu son l’Encyclique Spe Salvi en contemplant "Marie, Étoile de l’Espérance". Ses dernières paroles sont une prière : "Tu demeures au milieu des disciples comme leur Mère, comme Mère de l’Espérance. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, enseigne-nous à croire, espérer et aimer avec toi. Indique-nous la voie vers son royaume ! Étoile de la mer, brille sur nous et guide-nous sur notre chemin !" (Spe Salvi, n. 50). III/ Le Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge de saint Louis-Marie de Montfort - Le chef d’oeuvre de saint Louis-Marie Jean-Paul II, dans la grâce de sa béatification et de sa canonisation nous invite donc à redécouvrir le livre qui a eu tant d’influence sur toute sa vie : le Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge qui est le chef-d’oeuvre de saint Louis-Marie de Montfort. Ce Traité, écrit probablement en 1712 mais découvert seulement en 1842, est la synthèse finale de la doctrine contenue dans l’ensemble de ses Œuvres précédentes, spécialement les Cantiques, les écrits sur le Saint Rosaire, et par-dessus tout son premier grand traité intitulé l’Amour de la Sagesse Éternelle12. Le Traité est le chef-d’œuvre d’un saint prêtre, un missionnaire et un mystique, orienté vers les plus pauvres et les plus petits. Né en 1673 en Bretagne, Louis-Marie avait reçu une excellente formation culturelle, spirituelle et théologique, de niveau universitaire, d’abord au Collège des Jésuites de Rennes puis au Séminaire de Saint Sulpice à Paris, suivant aussi des cours à la Sorbonne. Ordonné prêtre en 1700, il déploie une intense activité missionnaire dans les provinces de l’ouest de la France (Vendée et Bretagne) jusqu’à sa mort en 1716. Sa doctrine spirituelle est profondément enracinée dans la Bible, dans la théologie des Pères et des Docteurs de l’Église avec l’influence des grandes spiritualités (ignacienne, dominicaine, franciscaine, carmélitaine…) On pourrait justement le comparer à saint Jean de la Croix qui avait étudié à Salamanque. Ce sont deux saints prêtres qui unissent une solide formation théologique et une profonde expérience mystique, et qui ont la même intention d’enseigner à leurs frères le chemin de la sainteté. Louis-Marie est considéré comme un des plus grands maîtres de l’École Française de spiritualité, inaugurée par le Cardinal de Bérulle13 au début du XVIIe siècle, et caractérisée par un très fort christocentrisme, fondé sur la contemplation du Mystère de l’Incarnation, avec une très riche doctrine concernant Marie et l’Église Corps Mystique du Christ14. Pour sa part, saint Louis-Marie s’efforcera toujours de rendre accessible aux pauvres et aux petits cette grande doctrine spirituelle, avec un style clair, vivant et ardent, en utilisant souvent des paraboles, des images, des symboles. Le manuscrit autographe du Traité est incomplet : il manque quelques pages au début et à la fin. Ainsi il n’a pas de titre. Donc, le titre traditionnel de Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge n’est pas original, il n’est pas de l’Auteur mais des éditeurs. Ce titre n’est pas très heureux parce qu’il n’exprime pas le christocentrisme qui caractérise toute l’œuvre. Au contraire, le premier grand traité de Louis-Marie était intitulé L’Amour de la Sagesse Éternelle qui est le Christ. Dans cette lumière, pour la nouvelle édition du texte que j’ai préparé pour le grand jubilé de l’an 2000, j’ai proposé comme titre L’Amour de Jésus en Marie15, en publiant successivement le texte du Traité, et celui du Secret de Marie qui est comme un bref et fidèle résumé du Traité fait par l’auteur lui-même. C’est exactement la même doctrine qui est exposée dans les deux œuvres, avec le même ordre dans la présentation de la synthèse. Si le Secret est plus bref que le Traité, d’une certaine manière il est plus complet, avec l’introduction et la conclusion qui manquent dans le manuscrit du Traité, avec la perte des premières et des dernières pages. En particulier il manque la prière de consécration qui se trouvait sûrement après l’actuelle finale eucharistique. Dans L’Amour de la Sagesse Éternelle, cette prière de consécration était la conclusion de toute l’œuvre (ASE 223-227). Le Secret commence avec une très importante introduction sur la vocation universelle à la sainteté (SM 1-6), et s’achève avec une conclusion qui contient précisément la prière de consécration (66-69) et la parabole de l’Arbre de Vie (70-78). Cette prière est adressée successivement à Jésus (66), à l’Esprit Saint (67) et à Marie (68-69) ; elle se présente comme le renouvellement de la consécration. C’est l’expression la plus développée de la consécration montfortaine, la plus riche du point de vue théologique. - Une synthèse nouvelle et originale En s’inscrivant dans la continuité des œuvres précédentes, et spécialement de L’Amour de la Sagesse Éternelle, le Traité est une admirable synthèse des plus grandes vérités de la foi et de la vie chrétienne, avec toutes les caractéristiques d’un chef-d’œuvre classique. Ainsi le définissait Jean-Paul II au début de sa Lettre aux Familles Monfortaines, dans le premier sous-titre : « un texte classique de la spiritualité mariale ». C’est une œuvre brève, simple et dense, qui va à l’essentiel. C’est une synthèse vivante, fruit de l’expérience et de la réflexion, toute entière orientée vers la vie, vers la « pratique ». C’est une synthèse harmonieuse, construite avec le plus grand soin. Ce qui constitue la nouveauté, l’originalité et aussi la beauté de cette synthèse, c’est son lieu qui est Marie : Inséparablement dans son Cœur Immaculé qui a accueilli avec Foi et Amour la Parole du Père, et en son Corps Virginal de Mère, où la même Parole est devenue Chair par l’action de l’Esprit Saint. Par l’action du même Esprit, Marie « recueille en son Cœur » (Lc 2,19) et "conçoit dans son sein" (Lc 2,22) la même Parole, le Fils du Père qui devient son Fils, « le fruit de son sein » (Lc 1,42). Il convient de comparer cette nouvelle synthèse théologique de Louis-Marie avec celles de Catherine de Sienne et de Thérèse d’Avila, Docteurs de l’Église. Le lieu de la synthèse théologique est pour Catherine le Corps de Jésus ; pour Thérèse d’Avila c’est notre âme, tandis que pour Louis-Marie c’est Marie en son Corps et en son âme. En effet, pour Catherine, Corps de Jésus, mort et ressuscité, est comme le Livre où il a lui-même écrit son Amour pour nous, non avec l’encre mais avec son Sang, non sur le papier, mais sur sa propre Chair ; comme l’Échelle ou le Pont qui relie la terre au Ciel ; comme le Temple de la totale présence de Dieu (« en Lui habite corporellement toute la Plénitude de la Divinité » ; Col 2,9), où toute l’humanité pécheresse est appelée à entrer en passant par la porte toujours ouverte de son Côté pour devenir l’Église son Épouse, comme sa côte près de son Cœur. Le lieu de la synthèse de Thérèse d’Avila est notre âme considérée comme Château Intérieur, où Dieu lui-même habite, merveilleuse architecture aux nombreuses Demeures, jusqu’aux Septièmes Demeures où resplendit la Lumière de la Trinité et de l’Humanité glorieuse de Jésus (cf Château Intérieur, VIIe Demeures, ch. 1 et 2). Toutes ces synthèses ont le même caractère christocentrique : Jésus en Marie (Louis-Marie), nous en Lui (Catherine), Lui en nous (Thérèse). De même encore, la synthèse de saint Thomas, la Somme Théologique, est aussi une architecture, comme une cathédrale gothique de son époque, symbole du Corps de Jésus Mort et Ressuscité « temple nouveau » dans lequel « habite toute la plénitude de la divinité corporellement », et où toute l’humanité est appelée à entrer. C’est le grand thème de notre incorporation dans le Christ également développé par Catherine et Thomas avec des styles théologiques différents. Pour sa part, Thérèse de Lisieux est plus proche de sa Mère Thérèse d’Avila : Lui en nous, dans notre âme. Mais cela devient encore plus concret dans son Histoire d’une âme. Ainsi, pour Louis-Marie, contempler et aimer « Jésus vivant et régnant en Marie » (VD 248) c’est découvrir toute la splendeur de son Mystère divin et humain, dans sa communion éternelle avec le Père et l’Esprit Saint, dans toutes les œuvres de la Création et du Salut de l’Humanité, comme « centre du Cosmos et de l’Histoire » ; c’est partager la foi, l’espérance et l’amour de Marie pour Jésus, son union si intime avec Lui, en acceptant dans sa propre vie toutes les exigences de l’Évangile. Avec Marie et en Marie, il ne peut plus y avoir de séparation entre la foi et la vie. La sainte Mère de Dieu dit au disciple inséparablement les grandes vérités de la foi concernant son Fils et les exigences de son Amour, en répétant toujours : « Faites tout ce qu’il vous dira » (cf Jn 2,5). En cela, le Traité est dans la pure ligne de la théologie patristique, dont il est imprégné et dans laquelle les vérités de la foi apparaissent toujours comme des vérités de vie, et non pas comme des concepts abstraits. La foi christocentrique et trinitaire professée dans le symbole baptismal est comme « vérifiée » dans la vie chrétienne qui s’épanouit en expérience de divinisation. L’architecture du Traité ressemble à celle d’un jardin. C’est un des grands symboles de Marie Mère et Épouse : « Paradis terrestre du Nouvel Adam » (VD 18, 45, 248, 261 en référence à Gn 2 et 3), « Jardin clos » de l’Esprit Saint (VD 263, SM 20, en référence à Ct 4, 12). Quasiment contemporain des plus beaux « jardins à la française » (Versailles), le chef-d’œuvre de Louis-Marie est soigneusement construit, selon une architecture précise, très « géométrique », en cette harmonie sobre et dépouillée qui caractérise le classicisme français, à la différence du style baroque. L’auteur lui-même a indiqué les articulations de son œuvre16. Le Traité comprend deux grandes parties (VD 1-89 et 90-273) qui contiennent de nombreuses subdivisions énumérées par Louis-Marie : « cinq vérités fondamentales » de la vraie dévotion à Marie (VD 60-89) ; « sept sortes de faux dévots et de fausses dévotions à Marie » (92-104) ; cinq caractéristiques de la vraie dévotion (105-114) ; huit « motifs qui nous doivent rendre cette dévotion recommandable » (135-182), le « cinquième motif », est divisé lui-même en quatre points ; « cette dévotion est une chemin aisé, court, parfait, assuré, pour arriver à l’union avec Notre-Seigneur où consiste la perfection du chrétien » (152-167). Enfin, les « pratiques de cette dévotion » sont présentées d’abord sous la forme de sept « pratiques extérieures » (226-256), puis sous la forme d’une « pratique intérieure » développée en quatre points : « c’est en quatre mots de faire toutes ses actions PAR MARIE, AVEC MARIE, EN MARIE ET POUR MARIE, afin de les faire plus parfaitement par Jésus Christ, avec Jésus Christ, en Jésus et pour Jésus » (257-265). Ensuite, cette pratique intérieure est présentée à son sommet dans la communion eucharistique (266-273). La présentation de cette pratique intérieure et de sa réalisation dans l’eucharistie est la finale et le couronnement du Traité (et non pas un "supplément", selon l’expression malheureuse des éditeurs). La communion eucharistique pleinement vécue avec Marie est le sommet de l’union mystique. C’est la "mystique du sacrement" dont parle Benoît XVI dans sa première Encyclique Deus caritas est (n. 13). Ainsi rattachée à l’expression christocentrique qui conclut la prière eucharistique « Par Lui, avec Lui, en Lui », l’expression montfortaine « par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie », veut signifier une réalité englobante. Il est important de ne pas durcir l’apparent systématisme, le caractère un peu trop « carré », géométrique de telles expressions, mais de bien les comprendre dans leur vivante complémentarité. Ainsi l’expression « en Marie » qui signifie l’union la plus intime et la plus intérieure avec Jésus, complète heureusement l’expression « par Marie », laquelle prise isolément pourrait être mal comprise, comme si la médiation de Marie « s’interposait » entre Jésus et nous. En réalité, le fidèle qui vit en Marie est uni à Jésus de la manière la plus intime et immédiate17 ; l’Esprit Saint lui fait partager l’union de Marie avec Jésus et l’identifie à Jésus. L’auteur veut s’exprimer brièvement et avec la plus grande clarté. Conformément à ce symbole du jardin, on peut tout contempler dans les grandes perspectives tracées par l’auteur : de la symphonie trinitaire du début (VD 1-36) à la finale eucharistique (VD 266-273). En effet, la première partie du Traité, qui expose les fondements théologiques de la Vraie Dévotion à Marie (c’est-à-dire Marie dans le Mystère du Christ et de l’Église), contemple principalement les Mystères de la Trinité, de l’Incarnation et du Corps Mystique. Puis, la seconde partie, qui illumine le chemin spirituel vécu avec Marie dans l’Église (la Vraie Dévotion dans sa forme la plus parfaite), s’inscrit dans une dynamique qui va du Baptême à l’Eucharistie. On perçoit clairement d’une part l’harmonie entre le Mystère de la Trinité et le sacrement du baptême qui plonge l’homme dans la Trinité, et d’autre part l’harmonie entre les Mystères de l’Incarnation et du Corps Mystique et le sacrement du Corps de Jésus. Comme la Somme Théologique de saint Thomas d’Aquin, le Traité de Louis-Marie est entièrement articulé selon la dynamique exitus et reditus : aller et retour entre Dieu et l’homme dans le Christ Jésus, et cela dans la succession des deux parties. La Première Partie (VD 1-89) est animée par le mouvement « descendant » de l’amour de Dieu vers l’homme, dans l’Incarnation et dans la Passion. La Seconde Partie (VD 90-273) est animée par le mouvement « ascendant » de l’amour de l’homme vers Dieu, un amour qui est répandu dans son cœur par l’Esprit-Saint selon la grâce du baptême (VD 118-133), et qui le conduit à la plus haute union avec le Dieu-Homme dans l’Eucharistie (VD 266-273). Cette seconde partie, la plus longue du Traité, est le chemin ascendant de notre divinisation qui présuppose le chemin descendant de l’Incarnation. Comme « Voie, Vérité et Vie », Jésus est toujours au centre, et Marie occupe la même place, dans le sens de sa venue à nous, comme dans le sens de notre retour à Lui. C’est en effet le principal leitmotiv du Traité : la place de Marie dans le Mystère du Christ, qui est la Voie de Dieu vers l’homme et la Voie de l’homme vers Dieu, dans cette grande dynamique d’aller et de retour, de descente et de remontée18. Marie est intimement présente dans cet « admirable échange » entre Dieu et l’homme dans le Christ Jésus. Louis-Marie le dit de façon brève dans le Secret : "Il faut pour monter et s’unir à lui, se servir du même moyen dont il s’est servi pour descendre à nous, pour se faire homme et pour me communiquer ses grâces. Et ce moyen est une vraie dévotion à la Sainte Vierge"19. Louis-Marie a toujours soin de souligner l’orientation christocentrique : "A Jésus par Marie"20. « Aller à Lui », « monter et s’unir à Lui » c’est proprement le chemin de la sainteté, à laquelle tous les hommes sont appelés, parce que, selon les paroles de Louis-Marie, la vocation universelle à la sainteté est fondée dans les mystères de la Création et de la Rédemption. Ainsi il déclare solennellement à son lecteur : « Âme, image vivante de Dieu et rachetée du Sang précieux de Jésus-Christ, la volonté de Dieu sur vous est que vous deveniez sainte comme lui dans cette vie, et glorieuse comme lui dans l’autre. L’acquisition de la sainteté de Dieu est votre vocation assurée » (SM 3). Tout homme est créé à l’image de Dieu et est racheté par le Christ. - Une théologie de la maternité, dans l’ordre de la nature et dans l’ordre de la grâce Comme « Théologien de classe », formé à l’école de saint Thomas, notre saint a une vision très juste du rapport entre nature et grâce, en leur distinction et aussi harmonie et complémentarité, puisque Dieu lui-même est l’Auteur de la nature et de la grâce. Selon ses paroles, l’indicible beauté de Marie vient du fait qu’elle est le chef-d’œuvre « de la grâce, de la nature et de la gloire » (VD 12). Sa contemplation de la maternité synthétise très bien les deux niveaux de la nature et de la grâce. Parmi les nombreux textes sur le sujet, nous pouvons en citer un qui est exemplaire, quand il veut expliquer l’indicible amour maternel de Marie envers nous, ses enfants : Elle les aime tendrement, et plus tendrement que toutes les mères ensemble. Mettez, si vous pouvez, tout l’amour naturel que les mères de tout le monde ont pour leurs enfants, dans un même cœur d’une mère pour un enfant unique : certainement, cette mère aimera beaucoup cet enfant ; cependant, il est vrai que Marie aime encore plus tendrement ses enfants que cette mère n’aimerait le sien (VD 202). Il est évident qu’une telle théologie, si juste, « parle au cœur », touchant une des « cordes » les plus sensibles du cœur humain, l’amour de l’enfant pour sa mère, l’expérience que tout être humain fait de l’amour maternel. S’il ne l’a pas vécu, il est profondément blessé, mais dans la rencontre avec Marie il peut en faire la merveilleuse expérience. Pour exprimer le rôle maternel de Marie dans notre sanctification, Louis-Marie utilise deux paraboles de la maternité : celle du « moule » et celle du « sucre », présentes dans le Traité et dans le Secret. D’abord, la maternité de Marie est comparée à un « moule » parfait dans lequel l’Esprit Saint forme continuellement les membres du Christ pour les rendre pleinement semblables à la Tête (VD 218-221 et SM 16-18). La personne qui vit le Totus Tuus se met tout entière dans ce saint « moule » en se laissant modeler par l’Esprit Saint. Nous pouvons citer ici le texte du Secret : Marie est appelée par saint Augustin, et l’est, en effet, le [moule] vivant de Dieu, forma Dei, c’est-à-dire que c’est en elle seule que Dieu [fait] homme a été formé au naturel, sans qu’il lui manque aucun trait de la Divinité, et c’est aussi en elle seule que l’homme peut être formé en Dieu au naturel, autant que la nature humaine en est capable, par la grâce de Jésus Christ. Un sculpteur peut faire une figure ou un portrait au naturel en deux manières : 1° se servant de son industrie, de sa force, de sa science et de la bonté de ses instruments pour faire cette figure en une matière dure et informe ; 2° il peut la jeter en moule. La première est longue et difficile et sujette à beaucoup d’accidents : il ne faut souvent qu’un coup de ciseau ou de marteau donné mal à propos pour gâter tout l’ouvrage. La seconde est prompte, facile et douce, presque sans peine et sans coûtage, pourvu que le moule soit parfait et qu’il représente au naturel ; pourvu que la matière dont il se sert soit bien maniable, ne résistant aucunement à sa main. Marie est le grand moule de Dieu, fait par le Saint-Esprit, pour former au naturel un Homme Dieu par l’union hypostatique, et pour former un homme Dieu par la grâce. Il ne manque à ce moule aucun trait de la divinité ; quiconque y est jeté et se laisse manier aussi, y reçoit tous les traits de Jésus-Christ, vrai Dieu, d’une manière douce et proportionnée à la faiblesse humaine, sans beaucoup d’agonie et de travaux ; d’une manière sûre, sans crainte d’illusion, car le démon n’a point eu et n’aura jamais d’accès en Marie, sainte et immaculée, sans ombre de la moindre tache de péché. Oh ! chère âme, qu’il y a de différence entre une âme formée en Jésus-Christ par les voies ordinaires de ceux qui, comme les sculpteurs, se fient en leur savoir-faire et s’appuient sur leur industrie, et entre une âme bien maniable, bien déliée, bien fondue, et qui, sans aucun appui sur elle-même, se jette en Marie et s’y laisse manier à l’opération du Saint-Esprit ! Qu’il y a de taches, qu’il y a de défauts, qu’il y a de ténèbres, qu’il y a d’illusions, qu’il y a de naturel, qu’il y a d’humain dans la première âme ; et que la seconde est pure, divine et semblable à Jésus-Christ ! (SM 16-18). Ici on voit très bien la sûreté théologique de notre saint, dans sa manière de parler de la maternité virginale de Marie dans une perspective christologique, pneumatologique et ecclésiologique. L’autre parabole, celle du « sucre »(VD 153-154 ; SM 22) est inspirée par l’expérience naturelle de l’amour maternel : ce qu’une mère est capable d’inventer pour guérir son enfant malade, en mettant un médicament amer dans la sucre. Ainsi fait Marie pour nous aider à boire l’indispensable et inévitable calice très amer de la Passion de Jésus, pour accepter toujours la croix, sans jamais la refuser. Ce « sucre » est la douceur de l’Esprit Consolateur qui nous est donné à travers son amour maternel. Ici nous citerons encore le texte résumé du Secret : Ce n’est pas que celui qui a trouvé Marie par une vraie dévotion soit exempt de croix et de souffrances, tant s’en faut ; il en est plus assailli qu’aucun autre, parce que Marie, étant la mère des vivants, donne à tous ses enfants des morceaux de l’Arbre de vie, qui est la croix de Jésus, mais c’est qu’en leur taillant de bonnes croix, elle leur donne la grâce de les porter patiemment et même joyeusement ; en sorte que les croix qu’elle donne à ceux qui lui appartiennent sont plutôt des confitures ou des croix confites que des croix amères ; ou, s’ils en sentent pour un temps l’amertume du calice qu’il faut boire nécessairement pour être ami de Dieu, la consolation et la joie, que cette bonne Mère fait succéder à la tristesse, les animent infiniment à porter des croix encore plus lourdes et plus amères (SM 22). Dans sa grande simplicité, cette parabole de l’amour maternel vient illuminer ce qui est sans doute le plus grand problème de la vie spirituelle : la nécessité d’accepter toujours la Croix de Jésus, de boire le Calice de son Agonie. Dans les moments plus douloureux, la grande tentation est de s’arrêter, de refuser l’épreuve21. Marie, qui est un pur « oui », l’unique créature qui a suivi Jésus jusqu’au fond de la souffrance de sa Passion Rédemptrice, a cette mission maternelle de nous aider puissamment et efficacement à dire toujours « oui » et à ne jamais nous arrêter sur le chemin de la sainteté. Conclusion Au terme de ce parcours, Jean-Paul II nous invite à redécouvrir l’immense valeur doctrinale de ce chef d’oeuvre qu’est le Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge, et cela dans la grâce de l’Année de la Foi et de sa prochaine canonisation. Jean-Paul II a déclaré sainte Thérèse de Lisieux Docteur de l’Eglise en 1997 et il avait l’intention de donner le même titre à saint Louis-Marie de Montfort. J’ai personnellement beaucoup travaillé pour ces deux Doctorats avec la même méthode et la même conviction. L’un s’est déjà réalisé, et l’autre pas encore. Mais je suis convaincu que les paroles de Benoît XVI au moment de la béatification de Jean-Paul II sont la meilleure invitation à continuer le travail en vue du Doctorat de Louis-Marie, en montrant comme Jean-Paul II l’harmonie profonde entre sa doctrine et l’enseignement du Concile Vatican II et aussi sa grande convergence avec Thérèse de Lisieux pour montrer à tous le chemin de la sainteté. L’Histoire d’une âme et le Traité de la Vraie Dévotion sont comme deux "phares" pour éclairer ce chemin de foi, d’espérance et d’amour, cette même "voie de confiance et d’amour" où l’Eglise ne cesse de cheminer avec Marie vers la pleine communion avec Jésus dans l’Esprit-Saint. Ces deux livres invitent le lecteur à vivre pleinement la grâce de son baptême en se donnant tout entier à Jésus dans l’Esprit-Saint, par les mains et le Coeur de Marie. Notre Pape François a déjà clairement situé son Pontificat dans la continuité de ce cheminement marial et ecclésial, dans la ligne de ses saints prédécesseurs : Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul II. 1 Toutes ces méditations ont été publiées, d’abord en italien, puis en français. F.M. LETHEL : La Luce di Cristo nel Cuore della Chiesa. Giovanni Paolo II e la teologia dei santi (Libreria Editrice Vaticana, 2011) ; La Lumière du Christ dans le Coeur de l’Eglise. Jean-Paul II et la théologie des saints (Paris, ed. Parole et Silence, 2011). J’ai écrit de nombreux articles sur Thérèse et Louis-Marie et j’ai dirigé quantité de thèses et de mémoires à leur sujet, en particulier la belle thèse de doctorat du P. Etienne RICHER : Suivre Jésus avec Marie. Un secret de sainteté de Grignion de Montfort à Jean-Paul II (Ed des Béatitudes, 2006). 2 A. FROSSARD : N’ayez pas peur ! 3 "Vous renouvellerez votre consécration en disant : Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt : Je suis tout à vous ma chère Maîtresse, avec tout ce que j’ai. Vous supplierez cette bonne Mère de vous prêter son cœur, pour y recevoir son Fils dans ses mêmes dispositions. […] Vous lui demanderez son cœur par ces tendres paroles : Accipio te in mea omnia. Praebe mihi cor tuum, o Maria !" (VD 266). Ce texte de Louis-Marie est adressé au fidèle pour sa pleine participation à l’Eucharistie, mais il a évidemment une valeur particulière pour le prêtre qui célèbre la messe chaque jour. Notre saint le dit, toujours à la fin du Traité, en invitant son lecteur à renouveler cette consécration mariale « avant de dire ou d’entendre la sainte Messe, de communier, etc. » VD 259). La spiritualité christocentrique et mariale de Montfort, vécue par Jean-Paul II, est essentiellement eucharistique. Nous indiquerons avec les sigles VD et SM le Traité de la vraie dévotion et le Secret de Marie, avec les numéros des paragraphes. Nous utiliserons le texte de l’édition critique des Œuvres complètes de saint Louis-Marie Grignion de Montfort (Paris, 1966, éd. du Seuil). 4 Je peux encore ajouter mon témoignage personnel, ayant été invité à déjeuner avec Jean-Paul II, en même temps que le Cardinal Ratzinger et un petit groupe de théologiens, en 1987. Nous avons parlé du Traité de Louis-Marie avec le Saint Père. J’étais assis à table à côté de Monseigneur Stanislas Dziwisz qui m’a dit : "Le Saint Père ouvre ce livre tous les jours !" 5 Ce point a été particulièrement approfondi par le Vénérable P. Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus ocd dans son grand livre Je veux voir Dieu (déjà cité dans la première méditation), dans la double perspective de la spiritualité carmélitaine et de l’École Française, fondée par le Cardinal de Bérulle (dont Montfort est un des plus grands représentants, étant justement appelé « le dernier des grands bérulliens »). Dans le livre du Père Marie-Eugène, il y a un chapitre fondamental sur le Don de soi (p. 322-335). 6 VD 144. Ce don réciproque rend l’homme profondément heureux : « Beatus Vir » ! C’est comme le cri du cœur de saint Louis-Marie, quand il dit à Jésus : « Oh ! qu’heureux est l’homme qui demeure dans la maison de Marie, où vous avez le premier fait votre demeure ! » (VD 196). La même heureuse expérience est exprimée toujours en référence aux paroles de l’Évangile : « Oh ! qu’un homme qui a tout donné à Marie, qui se confie et perd en tout et pour tout en Marie, est heureux ! Il est tout à Marie, et Marie est tout à lui. Il peut dire hardiment avec David : Haec facta est mihi : Marie est faite pour moi ; ou, avec le Disciple bien-aimé : Accepi eam in mea. Je l’ai prise pour tout mon bien, ou, avec Jésus-Christ : Omnia mea tua sunt, et omnia tua mea sunt : Tout ce que j’ai est à vous, et tout ce que vous avez est à moi » (VD 179). Dans la vie du prêtre, de l’homme consacré dans le célibat, il n’y a pas de doute qu’une telle relation avec Marie, la Nouvelle Ève, la Femme toute Belle et toute Sainte, est source de bonheur, de pureté, d’équilibre et aussi d’un rapport serein avec toutes les femmes. Le témoignage de Jean-Paul II a été exemplaire sur ce point. Un de ses plus beaux textes sur ce sujet est un texte inédit : sa brève Méditation sur le « Don Désintéressé », écrite par lui le 8 février 1994. 7 Nous l’indiquerons avec le sigle LFM. En référence à cette lettre j’ai publié dans la Revue de l’Académie Pontificale de Théologie un long article intitulé : Marie toute Sainte et Immaculée dans le Mystère du Christ et de l’Église : la doctrine de saint Louis-Marie Grignion de Montfort à la lumière du Concile Vatican II (PATH 2004/2). 8 Il convient donc, pour les nouvelles éditions du Traité, de publier d’abord cette Lettre de Jean-Paul II ainsi que le passage de l’homélie de Benoît XVI cité précédemment. 9 Saint Louis-Marie dit cela clairement au début de la deuxième partie du Traité : " Comme l’essentiel de cette dévotion consiste dans l’intérieur qu’elle doit former, elle ne sera pas également comprise de tout le monde : quelques-uns s’arrêteront à ce qu’elle a d’extérieur, et ne passeront pas outre, et ce sera le plus grand nombre ; quelques-uns, en petit nombre entreront dans son intérieur, mais ils n’y monteront qu’un degré. Qui est-ce qui montera au second ? Qui parviendra jusqu’au troisième ? Enfin, qui est celui qui y sera par état ? Celui-là seul, à qui l’Esprit de Jésus-Christ révélera ce secret, et y conduira lui-même l’âme bien fidèle pour avancer de vertus en vertus, de grâce en grâce, et de lumières en lumières pour arriver jusqu’à la transformation de soi-même en Jésus-Christ, et à la plénitude de son âge sur la terre et de sa gloire dans le ciel" (VD 119). 10 « Ah ! quand viendra cet heureux temps […] où Marie sera établie maîtresse et souveraine dans les cœurs, pour les soumettre pleinement à l’empire de son grand et unique Jésus ? Quand est-ce que les âmes respireront autant Marie que les corps respirent l’air ? Pour lors des choses merveilleuses arriveront dans ces bas lieux, où le Saint-Esprit, trouvant sa chère Épouse comme reproduite dans les âmes, y surviendra abondamment, et les remplira de ses dons, et particulièrement du don de sa sagesse, pour opérer des merveilles de grâce. Mon cher frère, quand viendra ce temps heureux et ce siècle de Marie, où plusieurs âmes choisies et obtenues du Très-Haut par Marie, se perdant elles-mêmes dans l’abîme de son intérieur, deviendront des copies vivantes de Marie, pour aimer et glorifier Jésus-Christ ? Ce temps ne viendra que quand on connaîtra et on pratiquera la dévotion que j’enseigne » (VD 217). 11 Sur ce point, un des témoins de son Procès de Béatification affirme :"Une clef de voûte pour mieux comprendre le Serviteur de Dieu , je crois que c’est sa profonde dévotion mariale. Pour lui, l’image de Marie était un archétype du chrétien, non seulement féminin, mais aussi pour les hommes. Une fois il m’a expliqué que Marie porte en elle-même Jésus, comme tout homme doit porter dans son propre cœur les personnes qu’il aime, pour les engendrer à la vie éternelle, c’est-à-dire à la vraie vie. L’homme naît vide et le destin de la vie au contraire de laisser que la présence des autres le remplisse, et le Serviteur de Dieu portait vraiment dans son cœur tous les hommes. Jean-Paul II disait que la Vierge est celle qui nous donne le don de la persévérance : résister à l’épreuve cet instant en plus qui permet à l’œuvre de Dieu de se manifester et de changer la vie. Il disait que Dieu seul connaît le cœur des hommes et qu’il est possible d’espérer pour tous. Il y avait chez le Serviteur de Dieu quelque chose qui rappelait sainte Thérèse d’Avila, comme la peur d’être sauvé en laissant derrière soi quelqu’un dans la damnation éternelle. Le Serviteur de Dieu répétait souvent que Jésus avait dit qu’il aurait attiré tous les hommes à lui-même et donc Jean-Paul II espérait pour tous. (…) Il avait fortement le sentiment que nous devons faire notre part, mais à la fin, c’est Dieu qui décide de la vie et de l’histoire. Ceci est aussi une des significations de sa devise Totus Tuus. Nous nous confions à Marie afin que nos intentions ne tombent pas dans le néant". 12 S.LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONTFORT, Œuvres Complètes (Paris, 1966, ed du Seuil, 1 vol). 13 Dans le Traité Louis-Marie fait un vibrant éloge du Cardinal de Bérulle (VD 162). Il est justement considéré comme « le dernier des grands bérulliens ». C’est en reprenant cette expression que le sulpicien R. Deville présente Louis-Marie dans son livre : L’École Française de Spiritualité, Paris, Desclée, 1987. 14 Dans le nouveau contexte de la modernité (en dialogue avec le jeune Descartes), Bérulle avait repensé le christocentrisme d’une manière vraiment géniale, comme dépassement de l’antithèse entre le théocentrisme du moyen âge et l’anthropocentrisme de la Renaissance. Son christocentrisme qui contemple le Verbe Incarné, le Dieu-Homme, comme le Centre de tout, est un véritable « théo-anthropocentrisme ». On pourrait parler du « tournant théo-anthropologique » de Bérulle qui a eu une influence énorme sur les saints, spécialement en France. Ce grand apport bérullien a été assimilé par la carmélite française Thérèse de Lisieux, à tel point que dans ses écrits, le Nom de Jésus se trouve à la première place, deux fois plus présent que le Nom de Dieu alors que, dans les écrits des saints précédents (comme saint Thomas, sainte Thérèse d’Avila, saint Jean de la Croix), le Nom de Dieu est plus fréquent que le Nom de Jésus. 15 L’Amour de Jésus en Marie. Le Traité de la Vraie Dévotion et le Secret de Marie, Genève, 2000, ed Ad Solem, 2 vol. 16 Par exemple VD 60, 90-91, 118, 134, etc. A partir de ces indications, il est possible de retrouver tout le projet tracé par l’auteur, jusque dans les détails. 17 Selon le Concile Vatican II, l’influence maternelle de Marie à notre égard « découle de la surabondance des mérites du Christ ; elle s’appuie sur sa médiation, dont elle dépend en tout et d’où elle tire toute sa vertu ; l’union immédiate des croyants avec le Christ ne s’en trouve en aucune manière empêchée, mais au contraire aidée » (Lumen Gentium, ch. VIII, n. 60). 18 Cf. VD 50, 75, 85, 125, 142, 152, 157 ; SM 23, 35 etc. 19 (SM 23). La même vérité est développée de manière splendide dans le Traité quand saint Louis-Marie présente cette dévotion à Marie comme « un chemin parfait » :"Cette pratique de dévotion à la Très Sainte Vierge est un chemin parfait pour aller et s’unir à Jésus-Christ, puisque la divine Marie est la plus parfaite et la plus sainte des pures créatures, et que Jésus-Christ, qui est parfaitement venu à nous n’a point pris d’autre route de son grand et admirable voyage. Le Très-Haut, l’Incompréhensible, l’Inaccessible, Celui qui Est, a voulu venir à nous, petits vers de terre, qui ne sommes rien. Comment cela s’est-il fait ? Le Très-Haut a descendu parfaitement et divinement par l’humble Marie jusqu’à nous, sans rien perdre de sa divinité et sainteté ; et c’est par Marie que les très petits doivent monter parfaitement et divinement au Très-Haut sans rien appréhender. L’Incompréhensible s’est laissé comprendre et contenir parfaitement par la petite Marie, sans rien perdre de son immensité ; c’est aussi par la petite Marie que nous devons nous laisser contenir et conduire parfaitement sans aucune réserve. L’Inaccessible s’est approché, s’est uni étroitement, parfaitement et même personnellement à notre humanité par Marie, sans rien perdre de sa Majesté, c’est aussi par Marie que nous devons approcher de Dieu et nous unir à sa Majesté parfaitement et étroitement sans craindre d’être rebutés.Enfin, Celui qui Est a voulu venir à ce qui n’est pas et faire que ce qui n’est pas devienne Dieu ou Celui qui Est ; il l’a fait parfaitement en se donnant et se soumettant entièrement à la jeune Vierge Marie, sans cesser d’être dans le temps Celui qui Est de toute Éternité ; de même, c’est par Marie que, quoique nous ne soyons rien, nous pouvons devenir semblables à Dieu, par la grâce et la gloire, en nous donnant à elle si parfaitement et entièrement, que nous ne soyons rien en nous-mêmes et tout en elle, sans crainte de nous tromper » (VD 157). 20 Ce qu’il affirme « absolument » à propos de Jésus il le dit « relativement » à propos de Marie (VD 74). Tel est le sens de la consécration qu’il enseigne : « Il s’ensuit qu’on se consacre tout ensemble à la Très Sainte Vierge et à Jésus-Christ : à la Très Sainte Vierge comme au moyen parfait que Jésus-Christ a choisi pour s’unir à nous et nous unir à lui ; et à Notre-Seigneur comme à notre dernière fin, auquel nous devons tout ce que nous sommes, comme à notre Rédempteur et à notre Dieu » (VD 125). 21 Spécialement pour accepter la terrible Nuit de l’esprit qui est la dernière et radicale purification, indispensable pour arriver à la sainteté. Décrite par saint Jean de la Croix, elle a été considérablement approfondie par le Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus (Je veux voir Dieu, p. 756-937), en montrant particulièrement le rôle maternel de Marie pour nous faire accepter et supporter cette épreuve (Ibid, p. 883-899). Zenit.org, 2006. Tous droits réservés - Pour connaitre les modalités d´utilisation vous pouvez consulter : www.zenit.org ou contacter infosfrench@zenit.org - Pour recevoir les news de Zenit par mail vous pouvez cliquer ici |