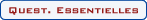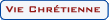4 novembre 2025 -
Saint Charles Borromée
4 novembre 2025 -
Saint Charles Borromée
Publié le : 22 mai 2014 Source : Zenit.org
Les newsLa feuille de route du pape pour les évêques italiens (2/2)Le pape appelle les pasteurs des Eglises locales à favoriser la vie consacrée : « Demandez aux consacrés, aux religieux et aux religieuses d’être de joyeux témoins : on ne saurait parler de Jésus en se lamentant. » Le pape François a ouvert la 66e Assemblée générale de la Conférence épiscopale italienne (CEI), en la salle du synode au Vatican, lundi dernier, 19 mai 2014. Dans une longue intervention, véritable « feuille de route », il a mis en lumière les tentations du pasteur : Tout d’abord celles qui « voilent le primat de Dieu » : « la tiédeur, la recherche d’une vie tranquille, la précipitation pastorale, la paresse, la présomption, se laisser aller à la tristesse... ». Puis les tentations qui menacent l’unité, « une responsabilité » qui « configure la mission » du pasteur : « les bavardages, les demi-vérités, la litanie des plaintes, la dureté, le laxisme, la jalousie, l’aveuglement, l’ambition, le passéisme… ». Enfin, les tentations qui « entravent le projet de Dieu sur la famille humaine » : la distinction entre "les nôtres" et "les autres", les fermetures, l’attente stérile de celui qui ne sort pas... Pour le pape, un des « lieux » où la présence des évêques est « la plus nécessaire » est « la famille », mais aussi « l’urgence historique » du chômage. Dans leur interaction avec les autres, les pasteurs doivent être "simples dans leurs modes de vie, détachés, pauvres et miséricordieux". Voici notre traduction de la deuxième et dernière partie de cette intervention (cf. Zenit du 21 mai 2014 pour la première partie). A.K. Allocution du pape François Face à ces tentations, l’antidote le plus efficace est précisément l’expérience ecclésiale. Celle-ci émane de l’unique Eucharistie, dont la force de cohésion génère fraternité, possibilité de s’accueillir, de se pardonner et de marcher ensemble ; l’Eucharistie, d’où jaillit la capacité de faire sienne une attitude de sincère gratitude et de conserver la paix même dans les moments les plus difficiles : cette paix qui permet de ne pas se laisser écraser par les conflits – qui peuvent aussi se révéler un creuset qui purifie – et de ne pas se laisser bercer par le rêve que l’on peut toujours recommencer ailleurs. La spiritualité eucharistique appelle à la participation et à la collégialité, pour un discernement pastoral qui se nourrit dans le dialogue, dans la recherche, dans l’effort de penser ensemble : ça n’est pas pour rien si Paul VI, dans le discours cité – après avoir défini le Concile « une grâce », « une occasion unique et heureuse », « un incomparable moment », « un sommet de charité hiérarchique et fraternelle », « une voix de spiritualité, de bonté et de paix au monde entier » – indique, comme « note dominante », la « libre et ample possibilité d’enquête, de discussion et d’expression ». Et ceci est important, au sein d’une assemblée. Chacun dit ce qu’il éprouve, en face, à ses frères ; cela édifie l’Église, cela aide. Sans honte, le dire, comme ça vient… Pour la Conférence épiscopale, c’est sa manière d’être un espace vital au service de l’unité, dans la valorisation des diocèses, même les plus petits. A partir des Conférences régionales, donc, ne vous lassez pas de tisser entre vous des relations favorisant l’ouverture et l’estime réciproque : la force d’un réseau repose sur des relations de qualité, qui abattent les distances et rapprochent les territoires à travers la confrontation, l’échange d’expériences, la volonté de collaboration. Nos prêtres, vous le savez bien, sont souvent éprouvés par les exigences du ministère et, parfois même découragés face aux maigres résultats : éduquons-les à ne pas s’arrêter pour calculer les entrées et sorties, pour vérifier si ce que l’on croit avoir donné correspond ensuite à ce que l’on a récolté : notre temps, plus que le temps des bilans, est un temps de patience dont le nom est l’amour mûr, la vérité de notre don de soi humble, gratuit et confiant à l’Église. Cherchez à leur garantir « proximité » et « compréhension », faites en sorte que dans votre cœur ils puissent se sentir toujours chez eux ; soignez leur formation humaine, culturelle, affective et spirituelle ; l’assemblée extraordinaire de novembre prochain, justement consacrée à la vie des prêtres, est une occasion pour préparer tout ça avec une attention particulière. Favoriser la vie religieuse : hier son identité était liée surtout aux actions, aujourd’hui elle constitue une précieuse réserve d’avenir, à condition de savoir se poser en signe visible, en sollicitation afin que tous vivent selon l’Évangile. Demandez aux consacrés, aux religieux et aux religieuses d’être de joyeux témoins : on ne saurait parler de Jésus en se lamentant ; d’autant que, lorsqu’on perd la joie, on finit par lire la réalité, l’histoire et sa propre vie sous une lumière déformée. Aimez avec générosité, et dans un total dévouement, les personnes et les communautés : ce sont vos membres ! Écoutez le troupeau. Fiez-vous à son sens de la foi et de l’Église, qui se manifeste aussi sous tant de formes de piété populaire. Ayez confiance que le saint peuple de Dieu a le pouls pour repérer les bons chemins. Accompagnez largement la croissance d’une coresponsabilité laïque ; reconnaissez les espaces de pensée, de conception et d’action des femmes et des jeunes : avec leurs intuitions et leur aide vous parviendrez à ne pas vous attarder sur une pastorale de conservation – de fait vague, dispersive, fragmentée et peu influente – pour assumer, au contraire, une pastorale qui met l’accent sur l’essentiel. Comme le résume, avec cette profondeur propre aux personnes simples, sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : « L’aimer et le faire aimer ». Que ceci soit aussi le noyau des Orientations pour l’annonce et la catéchèse que vous affronterez durant ces journées. Frères, dans un milieu comme le nôtre, souvent confus et déchiré, la première mission ecclésiale est d’être un levain d’unité, qui fermente dans la proximité et sous les différentes formes de réconciliation : ce n’est qu’ensemble que nous parviendrons – et ceci est le dernier trait du profil de Pasteur – à être « prophétie » du Royaume. 3. Pasteurs d’un Église anticipation et promesse du Royaume A ce propos, demandons-nous : Ai-je le regard de Dieu sur les personnes et sur les événements ? « J’ai eu faim…, j’ai eu soif …, j’étais un étranger …, nu…, malade…, j’étais en prison » (Mt 25,31-46) : est-ce que je crains le jugement de Dieu ? Par conséquent, est-ce que je me dépense, le cœur largement ouvert, pour répandre la semence du bon grain dans le champ du monde ? Ici aussi, on voit paraître les tentations qui, ajoutées à celles que nous venons de décrire, entravent la croissance du Royaume, le projet de Dieu sur la famille humaine. Celles-ci se manifestent dans la distinction que nous acceptons parfois de faire entre « les nôtres » et « les autres » ; dans les fermetures de ceux qui sont convaincus d’avoir suffisamment de problèmes eux-mêmes, sans devoir s’occuper de l’injustice qui est la cause de ceux des autres ; dans l’attente stérile de celui qui ne sort pas de son propre enclos et ne traverse pas la place, mais reste assis au pied du clocher, laissant le monde suive son chemin. Le souffle qui anime l’Église est bien autre chose. Cette dernière est continuellement convertie par le Royaume qui annonce et dont elle est anticipation et promesse : un Royaume qui est et qui vient, sans que quiconque puisse présumer le définir complètement ; un Royaume qui reste bien au-delà, plus grand que nos schémas et raisonnements, ou qui – peut-être plus simplement – est si petit, si humble et si caché dans la pâte de l’humanité, parce qu’il déploie sa force selon les critères de Dieu, qui s’est révélé dans la croix de son fils. Servir le Royaume exige une vie décentrée par rapport à soi-même, tendue vers la rencontre qui est le chemin pour retrouver vraiment ce que nous sommes : des personnes qui annoncent la vérité du Christ et sa miséricorde. Vérité et miséricorde : ne les séparons pas. Jamais ! « La charité dans la vérité – nous a rappelé le pape Benoît XVI – est la principale force propulsive pour le vrai développement de chaque personne et de l’humanité entière » (Enc. Caritas in veritate, 1). Sans vérité, l’amour se résout dans une boîte vide, que chacun remplit comme bon lui semble : et « un christianisme de charité sans vérité peut être facilement pris pour une réserve de bons sentiments, utiles pour la cohabitation sociale, mais marginaux » et qui, en tant que tels, n’influent pas sur les projets et sur les processus de construction du développement humain (ibid., 4). Que votre annonce, chers frères, s’accompagne tout aussi clairement de gestes éloquents. S’il vous plaît : l’éloquence des gestes. En tant que pasteurs, soyez simples dans vos modes de vie, détachés, pauvres et miséricordieux, pour marcher rapidement et ne rien interposer entre vous et les autres. Soyez totalement libres, pour pouvoir être proches des gens, attentifs à la langue de chacun, prêt à côtoyer chacun avec charité, en accompagnant les personnes dans leurs nuits de solitude, d’inquiétude et d’échecs : accompagnez-les, jusqu’à réchauffer leur cœur et les inciter à prendre un chemin qui ait un sens et rende à la vie sa dignité, ses espérances et sa fécondité. Un des « lieux » où votre présence est, me semble-t-il, la plus nécessaire et significative – et par rapport auxquels un excès de prudence condamnerait à l’insignifiance – est avant tout la famille. Aujourd’hui la communauté domestique est fortement pénalisée par une culture qui privilégie les droits individuels et transmet une logique du provisoire. Soyez des porte-paroles convaincus de celle qui constitue la première cellule de toute société. Témoignez de sa centralité et de sa beauté. Soyez les promoteurs de la vie à naître comme celle de la personne âgée. Soutenez les parents dans leur difficile et enthousiasmant chemin d’éducation. Et n’hésitez pas à vous incliner avec la compassion du samaritain sur celui qui est blessé dans ses sentiments et voit son projet de vie partir en fumée. Un autre espace qu’on n’a pas besoin aujourd’hui de décrire est celui de la salle d’attente bondée de chômeurs : chômeurs, pleinement ou partiellement, précaires, là où le drame de celui qui ne sait pas comment apporter du pain à la maison rencontre celui qui ne sait pas comment faire pour tenir son entreprise. C’est une urgence historique, qui interpelle la responsabilité sociale de tous : comme Église, aidons à ne pas céder au catastrophisme et à la résignation, en soutenant par toute forme de solidarité créative les efforts de ceux qui, avec le travail, se sentent atteints jusque dans leur dignité. Enfin, la chaloupe à mettre à l’eau est celle de l’étreinte accueillante à l’égard des migrants : ceux-ci fuient l’intolérance, la persécution, le manque d’avenir. Nul ne saurait détourner le regard ailleurs. La charité, dont témoignent tant de personnes par leur générosité, est notre manière de vivre et d’interpréter la vie : fort de ce dynamisme, l’Évangile continuera de se répandre en étant attractif. Plus généralement, que les situations difficiles vécues par tant de nos contemporains, vous trouvent attentifs et présents, prêts à rediscuter un modèle de développement qui exploite la création, sacrifie les personnes sur l’autel du profit et crée de nouvelles formes de marginalisation et d’exclusion. Le besoin d’un nouvel humanisme est crié par une société privée d’espérance, secouée dans toutes ses certitudes fondamentales, appauvrie par une crise qui, plus qu’économique, est culturelle, morale et spirituelle. Au vu d’un tel scénario, que le discernement communautaire soit l’âme du parcours de préparation au congrès ecclésial national de Florence, l’année prochaine : attention, s’il vous plaît, à ne pas s’arrêter au niveau – aussi nobles soit-elles – des idées, mais mettez les lunettes capables de saisir et comprendre la réalité et, donc, les chemins pour la gouverner, visant à rendre la communauté des hommes plus juste et fraternelle. Allez à la rencontre de quiconque demande raison de l’espérance qui est en vous : accueillez sa culture, tendez-lui avec respect la mémoire de la foi et la compagnie de l’Église, c’est-à-dire les signes de la fraternité, de la gratitude et de la solidarité, qui anticipent dans les jours de l’homme les reflets du Dimanche sans crépuscule. Chers frères, cette rencontre de ce soir, et plus généralement votre assemblée, est une grâce, une expérience de partage et de synodalité, un bon motif pour renouveler sa confiance en l’Esprit Saint : à nous de saisir le souffle de sa voix pour le servir en lui offrant notre liberté. Je vous accompagne par ma prière et ma proximité. Et vous, priez pour moi, surtout à la veille de ce voyage où j’irai en pèlerin à Amman, Bethléem et Jérusalem, 50 ans après la rencontre historique entre le pape Paul VI et le Patriarche Athénagoras : j’emporte avec moi votre proximité, visible et solidaire, à l’Église Mère et aux populations qui habitent la terre bénie où Notre Seigneur a vécu, où il est mort et ressuscité. Merci. Traduction de Zenit, Océane Le Gall Zenit.org, 2006. Tous droits réservés - Pour connaitre les modalités d´utilisation vous pouvez consulter : www.zenit.org ou contacter infosfrench@zenit.org - Pour recevoir les news de Zenit par mail vous pouvez cliquer ici |