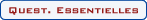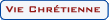5 novembre 2025 -
Sainte Sylvie
5 novembre 2025 -
Sainte Sylvie
Publié le : 28 février 2014 Source : Zenit.org
Les newsEurope : la famille diluée dans les droits de l’hommeDans un arrêt Vallianatos et autres c. Grèce (n° 29381/09 et 32684/09) rendu le 7 novembre 2013, la Cour européenne des droits de l’homme (la Cour) a estimé que deux hommes adultes vivant séparément devaient bénéficier de la protection accordée aux familles dans le cas particulier où ils entretiennent une relation homosexuelle stable. À cette occasion, la Cour a affirmé que, dorénavant, lorsqu’un État européen légifère en matière de famille, il « doit choisir les mesures (…) en tenant compte de l’évolution de la société ainsi que des changements qui se font jour dans la manière de percevoir les questions de société, d’état civil et celles d’ordre relationnel, notamment de l’idée selon laquelle il y a plus d’une voie ou d’un choix possibles en ce qui concerne la façon de mener une vie privée et familiale » (§ 84). La Cour veille ainsi à ce que les États européens adaptent leur législation à (sa propre perception de) l’évolution des mœurs. Cet arrêt marque une étape nouvelle dans la dissolution accélérée de la définition juridique de la famille qui, de réalité biologique et institutionnelle, est devenue une notion extensible jusqu’à l’incohérence. La famille constituée par le mariage ou/et les enfants La Convention européenne des droits de l’homme (la Convention) protège « la vie privée et familiale » dans une même disposition (article 8), avec le domicile et la correspondance, mais la Cour a progressivement distingué la protection de la vie privée de celle de la vie familiale. La vie privée est un concept large qui ne se prête pas à une définition exhaustive. Sa protection a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics et peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie privée (Olsson c. Suède, n°10465/83, 24.03.1988). Quant à la protection de la vie familiale, elle porte essentiellement sur les relations entre les enfants et leurs parents. Selon sa jurisprudence traditionnelle, la Cour considère que le droit au respect de leur vie familiale « présuppose l’existence d’une famille » (Marckx c. Belgique, n°6833/74, 13.06.1979, §31) ou, à tout le moins, l’existence d’une relation potentielle pouvant se développer, par exemple, entre un père naturel et un enfant né hors mariage (Nylund c. Finlande, déc., n°27110/95). Ainsi, la Cour estimait qu’à défaut de mariage, c’est l’existence d’un enfant qui était constitutive d’une vie familiale (Johnston c. Irlande, n° 9697/82, 18.12.1986). Un couple non marié et sans enfant ne pouvait donc prétendre bénéficier de la protection accordée aux familles (Elsholz c. Allemagne [GC], n° 25735/94, 13.07.2000). De façon très proche, la Déclaration universelle des droits de l’homme protège toute personne contre les « immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance » ainsi que contre les « atteintes à son honneur et à sa réputation » (article12). Si la Cour a longtemps conservé cette compréhension organique des rapports entre famille et société, l’évolution des mœurs l’a cependant amenée à reconstruire ce rapport. Certes, l’émergence des « droits LGBT » a contribué activement au bouleversement de la compréhension juridique de la famille. Toutefois, la cause de ce bouleversement est davantage à rechercher dans l’émergence d’un droit à la reconnaissance sociale des relations affectives et au mariage, conçue comme valeur autonome, comme une liberté individuelle indépendante de sa finalité sociale qu’est la fondation et la protection de la famille. Droits des personnes LGBT : de la vie privée à la vie familiale L’histoire de la jurisprudence relative aux « droits LGBT » est en partie l’histoire du passage de la protection accordée au titre de la vie privée à la protection accordée au titre de la vie familiale. Alors que, dans un premier temps, la Cour avait admis la pénalisation des relations homosexuelles (p. ex. Déc. Com.EDH n°104/55 du 17.12.1955, n°7215/75 du 7.07.1977), elle a considéré par la suite que ces relations devaient finalement être ignorées de la loi et revêtues de la protection accordée à la vie privée. Elle a ainsi censuré les ingérences de l’État constituées notamment par la pénalisation des relations homosexuelles entre adultes (Dudgeon c. Royaume-Uni, n°7525/76, 22.10.1981). Ce n’est que combinée au principe de non-discrimination, par comparaison à des personnes ou à des couples hétérosexuels, que l’invocation de la protection de la vie privée a permis de mieux protéger les droits des personnes homosexuelles. Il en a ainsi été par exemple en matière d’attribution de l’autorité parentale (da Silva Mouta c. Portugal, n°3290/96, 21.12.1999) ou d’agrément pour adopter un enfant (Fretté c. France, n°36515/97, 26.02.2002). Dans l’affaire Kerkhoven et Hinke c. Pays-Bas, (n°15666/89, 19.05.1992), la Commission avait refusé d’assimiler à une vie familiale une relation stable entre deux femmes et l’enfant mis au monde par l’une d’elles, accordant à cette relation la seule protection de la vie privée. C’est avec l’arrêt Schalk et Kopf c. Autriche (n°30141/04, 24.06.2010) que la Cour a modifié sa position, estimant que les relations homosexuelles excédaient le cadre de la vie privée et justifiaient une reconnaissance publique, non plus sous le volet répressif, mais en tant que mode légitime de vie familiale. Eu égard à l’évolution législative en Europe, la Cour a jugé en effet que la relation qu’entretient un « couple homosexuel cohabitant de fait de manière stable » relevait « de la notion de ‘’vie familiale’’ au même titre que celle d’un couple hétérosexuel se trouvant dans la même situation (§94) », et non plus seulement du domaine de la vie privée. Une vie familiale sans contenu objectif Finalement, à ce stade de l’évolution jurisprudentielle, quel est le contenu de la vie familiale au sens de l’article 8 ? Le sait-on encore, dès lors que, désormais, la vie familiale ne requiert pour exister ni engagement public, ni présence d’enfant, ni même cohabitation. Est-ce l’existence de sentiments qui permet de caractériser la « vie familliale » au sens de l’article 8 de la Convention ? Mais le droit a toujours ignoré les sentiments, considérant que ceux-ci relèvent de la vie privée, et non pas de la vie familiale, tout comme la sexualité consentie entre adultes (sauf cas particuliers). Est-ce alors la stabilité de la relation (Vallianatos, §73) ? Mais il s’agit-là d’un critère fort relatif. Deux affaires connexes renforcent le constat de perte de définition objective de la famille et de la vie familiale. Une définition arbitraire de la famille Finalement, dès lors que l’on a renoncé au mariage ou à la présence d’enfant comme critère de la vie familiale, il apparaît fort difficile d’établir d’autres critères objectifs, et donc non arbitraires. Plusieurs juges dissidents ont en substance reproché à l’arrêt Burden d’être arbitraire car purement positiviste. Mais qui décide de l’existence d’une vie familiale si les faits ne sont pas déterminants ? Est-ce le juge, la loi ou les personnes engagées dans la relation ? Si la décision appartient au juge et à la loi, elle sera alors contingente et relative à l’évolution culturelle. Dans un proche avenir, à l’occasion de deux affaires actuellement pendante à Strasbourg (Oliarai et A. contre Italie et Felicetti et autres contre Italie ; Francesca Orlandi et autres c Italie), la Cour pourrait prolonger la jurisprudence Vallianatos en estimant que tout couple menant une vie familiale doit, sans discrimination basée sur l’orientation sexuelle, avoir la faculté d’obtenir une reconnaissance officielle de sa relation dès lors qu’une telle reconnaissance est proposée à certains couples. Un tel constat obligerait les pays européens qui ne permettent pas le mariage homosexuel à proposer une forme de reconnaissance alternative et similaire aux couples de même sexe, telle que l’union civile. Si la Cour établit un tel droit, l’étape suivante sera alors le rehaussement des droits attachés à ce partenariat au niveau de ceux attachés au mariage. Au final, ces deux statuts se distingueront moins par les droits que par les devoirs qui demeureront peut-être plus importants dans le mariage. Ce processus de dissolution juridique de la « famille » n’est manifestement pas achevé : demeurent les questions de la polygamie, de l’inceste, des nouvelles formes de « multi-parentalité » et de l’inégalité des droits attachés au mariage et aux contrats d’union civile. Ce processus n’est pas un phénomène historique inéluctable, il est une succession de choix politiques et juridiques qui, pas à pas, ont conduit la Cour à l’opposé de l’intention initiale des rédacteurs de la Convention qui voulaient protéger les familles contre l’État, et non pas confier à l’État le pouvoir de définir la famille. La Cour de Strasbourg ne fait pas que suivre l’évolution des mentalités, elle la précède et l’oriente souvent, servant de « guide » aux juridictions et législateurs nationaux. --------------------------------- Zenit.org, 2006. Tous droits réservés - Pour connaitre les modalités d´utilisation vous pouvez consulter : www.zenit.org ou contacter infosfrench@zenit.org - Pour recevoir les news de Zenit par mail vous pouvez cliquer ici |