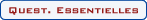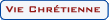18 juillet 2025 -
Saint Frederic
18 juillet 2025 -
Saint Frederic
Publié le : 26 novembre 2013 Source : Zenit.org
Les newsLe synode se reconnaît dans "La joie de l’Evangile"Le synode se reconnaît dans "La joie de l’Evangile", explique Mgr Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du synode des évêques, qui a présenté, ce mardi matin, 26 novembre, au Vatican, l’exhortation apostolique du pape François "La joie de l’Evangile", aux côtés de Mgr Fisichella et de Mgr Celli. Voici notre ptraduction intégrale, de l’italien, de l’intervention de l’archevêque. Présentation de Mgr Baldisseri Le document Evangelii Gaudium (EG) du pape François, fruit de la XIIIème Assemblée générale ordinaire du synode des évêques sur « La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne » (2012), est comme l’annonce d’une joie pour les chrétiens disciples et missionnaires et pour toute l’humanité. Le Saint-Père a eu entre les mains les « Propositions » des Pères synodaux, il les a faites siennes en les réélaborant de manière personnelles, et il a écrit un document qui est à la fois un programme et une exhortation sous la forme d’une « Exhortation apostolique » dont le cœur est la dimension missionnaire, tous azimuts. Ce qui frappe dès les premières pages, c’est la présentation joyeuse de l’Évangile – d’où Evangelii Gaudium – qui s’exprime directement par la répétition du mot « joie », qui revient 59 fois dans l’ensemble du texte. Le pape a tenu compte des « Propositions » qu’il cite 27 fois. Sur cette base, qui vient de la réflexion des Pères synodaux, il développe l’Exhortation à l’intérieur d’un solide cadre doctrinal, fondé sur les références bibliques et du Magistère, avec une présentation thématique des différents aspects de la foi, où sont affirmés les principes et les doctrines incarnées dans la vie. Ce développement est enrichi par des renvois aux Pères de l’Église, parmi lesquels saint Irénée, saint Ambroise et saint Augustin, pour n’en citer que quelques-uns ; il est ensuite soutenu par l’apport de Maîtres du Moyen-âge comme le bienheureux Isaac de l’Étoile, saint Thomas d’Aquin et Thomas a Kempis ; le bienheureux John Henry Newman, Henri de Lubac et Romano Guardini font partie des théologiens modernes évoqués, ainsi que d’autres écrivains comme Georges Bernanos. Il faut particulièrement noter les nombreuses références à des exhortations apostoliques comme Evangelii nuntiandi de Paul VI (13 occurences) et à d’autres exhortations post-synodales comme Christifideles laici, Familiaris consortio, Pastores dabo vobis, Ecclesia in Africa, in Asia, in Oceania, in America, in Medio Oriente, in Europa et Verbum Domini. On remarque aussi l’attention portée aux déclarations des épiscopats latino-américains, comme au documents de Puebla et d’Aparecida, à celui des patriarches catholiques du Moyen-Orient lors de la XVIème Assemblée, et à celles des Conférences épiscopales d’Inde, des États-unis, de France, du Brésil, des Philippines et du Congo. Le thème de la synodalité est déjà introduit à l’intérieur de la partie initiale qui traite de « La transformation missionnaire de l’Église ». Dans la perspective d’une « Église « en sortie » / « en partance » » (n.20) « sortie de soi vers le frère » (n.179), le Saint-Père propose une « pastorale de conversion » à 360 degrés, en partant de la paroisse (cf. n.28), des communautés de base, mouvements et autres formes associatives (cf. n.29) et des Églises particulières (cf. n.30) jusqu’à « penser à une conversion de la papauté » (n.32). On perçoit qu’il désire inclure dans cette « pastorale de conversion » une attention particulière à l’expression collégiale de l’exercice de la primauté ; c’est pourquoi il affirme : « La papauté aussi, et les structures centrales de l’Église universelle, ont besoin d’écouter l’appel à une conversion pastorale » (n.32). Se référant au concile Vatican II, en analogie avec les anciennes Églises patriarcales, le Saint-Père souhaite que les Conférences épiscopales puissent « contribuer de façons multiples et fécondes à ce que le sentiment collégial se réalise concrètement » (LG n.22 et EG n.32). Cette expression de la synodalité permettrait des attributions concrètes quant à l’autorité doctrinale et de gouvernement (cf. n.32). Sous un profil œcuménique – grâce aussi à l’expérience de la présence au synode du patriarche de Constantinople et de l’archevêque de Canterbury (cf. n. 245) – , la synodalité s’exprime de manière particulière puisque, à travers le dialogue « avec les frères orthodoxes, nous les catholiques, nous avons la possibilité d’apprendre quelque chose de plus sur le sens de la collégialité épiscopale et sur l’expérience de la synodalité » (n.246) Un autre élément significatif, à ce sujet, est représenté par l’accueil, dans l’Exhortation apostolique – qui est un document à caractère universel – des stimulations pastorales provenant des différentes Églises locales dans le monde. Cela signifie montrer l’exercice de la collégialité en acte. Dans ce sens, l’importance que donne le Saint-Père à la sortie missionnaire de l’Église vers les périphéries existentielles, à travers la conversion pastorale, provient de son expérience personnelle comme archevêque de Buenos Aires et du fait qu’il a été directement impliqué dans la rédaction du document d’Aparecida (cf. n.25). C’est à cette expérience pastorale que l’on doit également tout l’espace dédié à la piété populaire que « les évêques, en Amérique latine et aux Caraïbes, appellent aussi « spiritualité populaire » ou « mystique populaire ». Il s’agit d’une « véritable spiritualité incarnée dans la culture des simples » » (n.124). Faisant écho à une célèbre définition de saint Thomas, selon laquelle « la grâce présuppose la nature », le Saint-Père, puisant dans le document de Puebla, forge la belle expression : « la grâce présuppose la culture, et le don de Dieu s’incarne dans la culture de la personne qui le reçoit » (n.115). Cette appréciation ouverte pour les différentes cultures qui se disposent à accueillir l’Évangile et qui l’informe de leurs richesses, amène le Saint-Père à redimensionner le caractère prétendument absolu de toute culture : « il n’est pas indispensable d’imposer une forme culturelle particulière, aussi belle et antique qu’elle soit, avec la proposition de l’Évangile » (n.117). À ce propos, « les évêques d’Océanie ont demandé que, dans ces pays, l’Église « fasse comprendre et présente la vérité du Christ en s’inspirant des traditions et des cultures de la région » (n.118). D’autres thèmes sont abordés avec des références précises, provenant de différentes parties du monde. Le dialogue entre les religions, exprimé en termes d’ouverture dans la vérité et dans l’amour, est présenté par le texte du pape « en premier lieu comme une conversion sur la vie humaine ou simplement, comme le proposent les évêques d’Inde, « une attitude d’ouverture envers eux, partageant leurs joies et leurs peines » » (n. 250). Vis-à-vis de l’islam, « une formation adéquate des interlocuteurs est indispensable, non seulement pour qu’ils soient solidement et joyeusement enracinés dans leur propre identité, mais aussi pour qu’ils soient capables de reconnaître les valeurs des autres, de comprendre les préoccupations sous jacentes à leurs plaintes, et de mettre en lumière les convictions communes. […] Face aux épisodes de fondamentalisme violent qui nous inquiètent, l’affection envers les vrais croyants de l’Islam doit nous porter à éviter d’odieuses généralisations, parce que, comme l’ont enseigné les patriarches catholiques du Moyen-Orient, « nous savons bien que le véritable Islam et une adéquate interprétation du Coran s’opposent à toute violence » » (n.253). « La dimension sociale de l’évangélisation », à laquelle est dédiée une partie consistante du document, est particulièrement chère au Saint-Père, en raison de son urgence mondiale. L’expérience latino-américaine et des Caraïbes d’une Église profondément immergée dans la vie du peuple a provoqué une sollicitude attentive envers les pauvres, les exclus, les opprimés et a suscité aussi une grande réflexion théologique, dont les répercussions ont élargi les frontières, assumant des visages propres aux contextes, dans les diverses parties du monde qui participent de la même condition sociale (cf. n.176 sqq.). En exposant ce thème, le pape parle de l’inclusion sociale des pauvres, qu’il présente comme un cri pour la justice et la dignité, que l’Église doit écouter (cf. n.186 sqq.). Ce sont aussi les causes structurelles de la pauvreté qui sont en jeu. Il ne s’agit pas de la solidarité de proximité mais de transformations structurelles. « Un changement des structures qui ne génère pas de nouvelles convictions et attitudes fera que ces mêmes structures tôt ou tard deviendront corrompues, pesantes et inefficaces » (n.189). N’est pas exclu non plus le cri de peuples entiers qui réclament leurs droits en tant que nations, auxquels il doit être permis « de devenir eux-mêmes les artisans de leur destin ». (PP n.15, EG n.190). Enfin, au sujet du rapport entre le bien commun et la paix sociale, le pape affirme que « l’annonce de la paix n’est pas celle d’une paix négociée mais la conviction que l’unité de l’Esprit harmonise toutes les diversités » (n.230), parce que l’Esprit-Saint ipse armonia est. Traduction de Zenit, Hélène Ginabat Zenit.org, 2006. Tous droits réservés - Pour connaitre les modalités d´utilisation vous pouvez consulter : www.zenit.org ou contacter infosfrench@zenit.org - Pour recevoir les news de Zenit par mail vous pouvez cliquer ici |