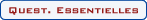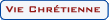7 septembre 2025 -
Saint Cloud
7 septembre 2025 -
Saint Cloud
Publié le : 22 mai 2011 Source : Zenit.org
Les newsL’islam en Zambie : Une petite minorité, mais très présenteROME, Dimanche 22 mai 2011 (ZENIT.org) - La communauté musulmane en Zambie représente une petite minorité, mais sa présence est devenue de plus en plus visible au cours des trois dernières décennies, selon un professeur de l’Institutpontifical d’études arabes et d’islamologie. Le père Felix Phiri, missionnaire en Afrique, est l’auteur livre « Muslim Associations and the Resurgence of Islam in Zambia » (Associations musulmanes et résurgence de l’islam en Zambie) Le père Phili a parlé de son travail et de l’islam en Zambie à l’émission de télévision « Là où Dieu pleure ». Q - Père Felix, qu’est-ce qui vous a conduit à écrire ce livre ? Pourquoi précisément ce livre ? Qu’est-ce qui vous a inspiré ? Principalement la force et la vitalité de la communauté musulmane dans notre pays. Peu avant que j’entame cette recherche, régnait dans la communauté musulmane une grande inquiétude et crainte qui, en grande partie, n’était pas fondée sur des informations objectives. Les gens spéculaient en se basant sur ce qu’ils voyaient et j’ai pensé que ce serait un sujet intéressant à traiter pour ma recherche, et aussi un moyen de susciter une prise de conscience claire de la réalité du pays. Y a-t-il une personne, ou peut-être un fait, qui a été un déclencheur ? Votre livre s’intitule « The resurgence of Islam », pourtant l’islam ne représente que 0.5% de la population. Que voulez-vous dire par résurgence – s’agit-il d’une progression de l’islam ? Vous dites que l’islam est arrivé en Zambie avant le christianisme. D’où venait-il ? Les premiers musulmans étaient des commerçants arabes qui, après une longue présence sur la côte orientale de l’Afrique, se sont aventurés, petit à petit, plus profondément dans le continent. De manière générale, ils sont venus en tant que commerçants, mais il s’est trouvé qu’ils étaient aussi musulmans. Dans leurs premières incursions sur le continent, ils n’ont pas diffusé l’islam, car leurs établissements n’étaient que provisoires. Mais, au fil du temps, certains de ces établissements sont devenus permanents et en traitant avec la population indigène - il y avait là quelques tribus qui collaborèrent étroitement avec eux - , quelques-unes de ces tribus se sont converties en masse à l’islam. Tel a été le cas, par exemple, d’une bonne partie de l’ethnie Yao du Malawi, qui a contribué également à la présence de l’islam en Zambie. Ce sont donc les deux premières communautés auxquelles nous pouvons attribuer l’arrivée de l’islam en Zambie. Les financements, par exemple pour la construction des mosquées, des hôpitaux et des écoles, proviennent-ils de sources locales ou d’autres pays arabes ou musulmans à l’étranger ? Il n’y a pas de preuves claires laissant penser qu’un pays musulman ou arabe sponsorise directement le développement de l’islam dans le pays si ce n’est, de façon indirecte, l’Agence des musulmans d’Afrique (AMA). Il s’agit d’une ONG caritative qui, d’une manière ou une autre, vient en aide pour la construction de mosquées ; mais elle le fait davantage par le biais d’une activité de coordination de la construction des édifices religieux, plutôt qu’en promouvant directement l’expansion de l’islam. Au sein de la communauté asiatique de Zambie, impliquée surtout dans le commerce et disposant des ressources locales et de fortes capacités d’organisation, ont été mises en place quelques structures simples, principalement dans les zones locales, qui ont été financées localement. De même, à titre individuel, certains riches musulmans venant de l’extérieur du pays font œuvre de charité à l’intérieur de l’Afrique. Ces familles individuelles viennent et parrainent la construction d’orphelinats et le forage de puits. Il y a donc des ressources qui viennent de l’extérieur du pays, c’est vrai, mais de façon spontanée, plus que coordonnée. Les activités caritatives font-elles partie intégrante de l’islam, ou s’agit-il de rivaliser avec les organisations caritatives chrétiennes ? Ce phénomène suscite ma curiosité car il semble relativement nouveau ? Comme notre aumône chrétienne ? Quelle est la réaction des chrétiens ? Sont-ils inquiets ? S’agit-il d’un argument valable ? Dans un sens c’est un argument valable, mais comme on l’a dit, les temps ont changé. La communauté musulmane fournit les mêmes services que fournissaient avant elle les missionnaires chrétiens, qui ont gagné de nombreux fidèles. Les musulmans font exactement la même chose. [...] La critique principale qui a été faite à ce type d’approche est que c’est une façon de tirer profit des pauvres dans la société, car les gens ont des besoins matériels ; ainsi au lieu de leur donner gratuitement ce dont ils ont besoin et de les laisser décider, d’une certaine manière indirectement, de la façon dont les services sont fournis, la personne sent que l’on attend quelque chose d’elle. Il s’agit d’une critique qui a été formulée à l’encontre de la communauté musulmane – dire qu’ils profitent des pauvres de la société et fournissent ces services pour obtenir de nouvelles conversions. Ceci soulève la question de la pertinence de ce choix de vie. S’il est effectué dans un moment de convenance ou de nécessité, jusqu’à quel point la foi pénètre-t-elle en profondeur dans la personne ? Quand les autres personnes, qui ne sont pas tombées dans ce type de tentation matérielle, demandent à leurs voisins pourquoi ils se sont laisser entraîner vers une autre religion pour des raisons d’ordre matériel, alors pour défendre leur dignité ils répondent que ce n’est pas seulement pour un attrait matériel, mais par conviction. Ils espèrent ainsi convaincre celui qui les interroge, et les critique, qu’ils sont des musulmans sincères. C’est ainsi que finalement l’ensemble du processus peut effectivement conduire à une conversion et une foi plus profondes. Même s’il s’en trouve quelques-uns, bien entendu – ceux qui sont seulement attirés par un intérêt matériel qui, voyant qu’ils ne tirent aucun autre profit, abandonnent. C’est une façon donc de les mettre à l’épreuve. Quelle est la réaction des chrétiens en Zambie ? Certains pays africains ont été témoins d’affrontements entre musulmans et chrétiens. Sont-ils préoccupés ? De quelle façon l’Église catholique cherche-t-elle à travailler avec les musulmans ? Il y a eu ici et là plusieurs tentatives pour tendre la main à la communauté musulmane. Certaines communautés locales même sont très ouvertes au dialogue avec les chrétiens et l’Église catholique en particulier, mais pour le moment, il n’existe pas de vraies structures permanentes ou moyens de coordination permettant une étroite collaboration entre les deux communautés. Le problème est que ce sont deux communautés missionnaires. Où cela mènera-t-il ? Comment nous concerter pour éviter une crise potentielle ? Quel a été l’effet du pape à Ratisbonne sur toute cette question ? Le Saint-Père a été critiqué mais, pour finir, certains dignitaires musulmans ont rédigé une lettre commune demandant le dialogue. Quelle importance cela a-t-il eu ? * * * Propos recueillis par Mark Riedermann pour l’émission télévisée « Là où Dieu pleure », conduite par la Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec l’association Aide à l’Eglise en détresse (AED). Sur le Net : Aide à l’Eglise en détresse France www.aed-france.org Aide à l’Eglise en détresse Belgique www.kerkinnood.be Aide à l’Eglise en détresse Canada www.acn-aed-ca.org Aide à l’Eglise en détresse Suisse www.aide-eglise-en-detresse.ch Zenit.org, 2006. Tous droits réservés - Pour connaitre les modalités d´utilisation vous pouvez consulter : www.zenit.org ou contacter infosfrench@zenit.org - Pour recevoir les news de Zenit par mail vous pouvez cliquer ici |