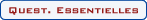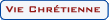8 juillet 2025 -
Saint Edgar
8 juillet 2025 -
Saint Edgar
Publié le : 10 février 2010 Source : Zenit.org
Les newsLes enjeux de l’adoption des enfants par des personnes de même sexeROME, Mercredi 10 Février 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de la conférence de Mgr Tony Anatrella1, qu’il a prononcée sur le thème « Les enjeux de l’adoption par des personnes de même sexe », ce 10 février à l’occasion de la 19e Assemblée Plénière du Conseil Pontifical pour la Famille. * * * Les droits de l’enfant à naître et à vivre dans une famille composée par un homme et une femme sont largement menacés. Ainsi, l’adoption et la possibilité d’user des moyens d’assistance médicale à la procréation (AMP) par des personnes de même sexe, tout comme le mariage, sont devenus des revendications politiques. Elles posent de sérieuses questions qui sont souvent éludées au nom de l’égalité des droits de tous les citoyens devant la loi. La réflexion est remplacée par un sentiment de compassion qui se résume à travers l’affirmation : « puisque des personnes de même sexe s’aiment marions-les et facilitons-leur l’accession à la filiation ». Formulation rapide et impensée car est-on certain qu’il s’agit d’amour alors que les conditions ne semblent pas réunies ? Le désir d’enfant dans sa dimension la plus imaginaire désarticulé de la chair, doit-il être ainsi légitimé ? Le questionnement va encore plus loin puisqu’au nom d’une vision contestable de la non-discrimination, on laisse entendre un sens absolu des droits, un sens purement sentimental du mariage à l’objet incertain et une conception instrumentale des enfants. Les droits s’accompagnent de devoirs et en particulier à l’égard des enfants. Un enjeu anthropologique L’enjeu ici n’est pas religieux comme certains le prétendent, mais anthropologique dans la mesure où la société, mais aussi le mariage et la filiation, ne peuvent reposer que sur un fait objectif : la différence sexuelle. La théorie du genre qui inspire les lois européennes et internationales affirme que la société ne doit plus dépendre de la différence sexuelle inscrite sur le corps mais de la différence des sexualités, c’est-à-dire des orientations sexuelles. Or celles-ci procèdent des pulsions partielles et sont dans un deçà de l’identité de l’homme et de la femme puisqu’il n’y a que deux identités : celles de l’homme et de la femme. Une pulsion ou, dans le même ordre d’idée, une préférence sexuelle, ne fait pas une identité. Le croire est une vision idéologique en contradiction avec la condition humaine. L’enfant provient de l’union de l’homme et de la femme et, de ce fait objectif, découle la relation éducative. L’intérêt de l’enfant est d’être dans les mêmes conditions de parenté qu’entre un père et une mère. Des enquêtes sociologiques ont voulu montrer que des enfants vivant dans un milieu homosexuel ne présentaient aucun trouble affectif, social et intellectuel. Mais leurs paramètres sont loin d’être pertinents et leurs conclusions servent davantage à justifier des présupposés que de prouver cet état de fait. Une forme d’idéalisme se dégage de ces travaux quand ils prétendent que les enfants ne vont rencontrer aucun problème en vivant avec des personnes homosexuelles. Autrement dit, ils voudraient nous faire croire que la relation entre elles et des enfants sera neutre et sans conséquences notables. En réalité au regard d’autres situations, nous observons que des enfants subissent déjà les effets insécurisants d’un couple disharmonieux, les effets d’une rupture d’unité psychique lors du divorce et les effets d’une crise de l’origine dans l’adoption : qu’en sera-t-il dans un milieu homosexuel aux effets dissonants entre la nature de leur origine et de la relation éducative, et comment nommer ces deux adultes qui se présentent comme leurs « parents » alors qu’ils sont dans l’autoparenté ? Une « parenté » autoproclamée par le sujet à travers son désir d’obtenir un enfant en forçant le réel. La loi civile pourra toujours inventer une fiction juridique de « parenté », cela ne changera en rien la vérité de la réalité de la génération. La modification du vocabulaire est également étrange lorsque le terme de « parenté » qui concerne les parents, les grands-parents et les collatéraux est remplacé par celui de « parentalité » pour désigner tous les adultes qui peuvent se succéder dans la vie de l’enfant en jouant un rôle parental. La transformation du langage est significative de la volonté de changer le sens de la famille qui ne dépendrait plus de la relation et d’un couple stable formé par un homme et par une femme. Toutes les situations particulières n’ont pas à être instituées et encore moins celles qui sont contraires à la procréation. Vouloir être parents comme les autres est une illusion égalitaire puisque ces personnes étant hors conjugal, ne peuvent pas l’être en justice. Il y va de l’intérêt de l’enfant. Comment ce dernier ne pourra-t-il pas se poser la question de la légitimité de ces adultes monosexués auprès de lui ? Quel statut aura pour l’enfant la sexualité unisexe de deux adultes ? Comment pourra-t-il se représenter sa conception en cohérence avec la conception universelle de la génération ? Il est trompeur de laisser entendre à des enfants qu’il y aurait plusieurs façons de les concevoir en dehors d’une relation formée par un homme et une femme. Le désir d’enfant, très louable dans la vie d’un adulte, se présente parfois de façon très complexe dans un couple ou dans la psychologie d’une femme, voire d’un homme et encore davantage lorsqu’ils ne peuvent pas concevoir des enfants dans des conditions normales. Chez des personnes homosexuelles, ce désir est souvent pathétique et troublant mais, en justice pour l’enfant, il n’est pas pertinent. Une vision égalitaire empêche, notamment en Europe, que les enfants soient uniquement adoptés et éduqués par un couple formé par un homme et une femme. Au nom de la non-discrimination basée sur l’orientation sexuelle, on prétend, sans autres éléments de réflexion, que quelle que soit la situation d’un homme ou d’une femme, ils seraient en mesure d’adopter un enfant. Une vision idéologique qui ne rend pas service à l’enfant. Nous oublions que les conditions dans lesquelles l’enfant est adopté, conditionnent sa vie et le destin de sa personnalité qui se révèle de nombreuses années après l’enfance. Il en va également de la représentation que se fait une société de la filiation. Je reçois comme psychanalyste des personnes homosexuelles qui sont dans diverses situations et avec elles je suis prêt à faire un travail sur leur vie psychique afin d’améliorer leur existence. Mais comme citoyen, je ne peux pas envisager que la société, par l’entremise du législateur, desserve le sens de la génération en le situant en dehors de la différence sexuelle. Il peut exister plusieurs formes de sexualités avec leurs lots de problèmes psychologiques, anthropologiques et moraux, mais il n’y a que deux sexes et ce donné de l’homme et de la femme a déjà un sens en soi et pour la génération qui ne saurait être modifié au gré des fantasmes et des frustrations des uns et des autres. Le droit de l’enfant doit toujours primer dans notre réflexion. Les besoins, l’intérêt de l’enfant et la cohérence du sens de la filiation méritent davantage de rationalité que de simples revendications subjectives. Il serait même foncièrement discriminatoire, injuste et illégitime au regard des droits de l’enfant de le priver de l’altérité sexuelle dans sa famille constituée par un homme et une femme. Toutes les compensations sociales que l’on imagine ne viendront jamais se substituer à l’expérience intrasubjective que l’enfant pourra faire à partir de la relation de sa mère avec son père. L’intérêt supérieur de l’enfant se situe dans cette perspective et non pas dans l’enveloppement affectif de deux personnes de même sexe. La question qui se pose n’est pas de savoir si ces personnes seront généreuses, loyales et honnêtes avec l’enfant, mais de savoir dans quelle structure relationnelle il sera engagé. La société actuelle a davantage tendance à privilégier les attentes affectives des adultes sans aucun discernement que de définir la filiation à partir des besoins et des droits de l’enfant qui limitent pourtant le narcissisme envahissant des adultes. La primauté de l’indistinction sexuelle dans le discours social Dans la perspective de la philosophie de la déconstruction, un stade conceptuel est actuellement franchi pour ne plus avoir à parler d’orientations sexuelles, en affirmant que la personnalité du sujet se construit dans l’indistinction sexuelle, laissant ainsi ouverts tous les choix possibles alors que le désir, qualifié d’orientation sexuelle, ne provient pas d’un choix mais d’un déterminisme psychique qui, dans bien des cas, peut se remanier vers la maturité de l’hétérosexualité. Le débat ne se porte donc plus sur la différence sexuelle, sur les orientations sexuelles (les désirs), mais sur l’état originel de la sexualité qui devrait être pensée selon les catégories de l’indistinction. Nous sommes dans une société qui entretient l’infantile au point de faire croire que la fin de la sexualité serait de la maintenir dans ses commencements : celle de l’économie de l’infantile basée sur les pulsions partielles, l’imaginaire, la captation violente de l’autre et les intrigues œdipiennes. Dans cette logique de l’indistinction primitive, chacun est renvoyé au supposé choix de son orientation sexuelle qui ferait son identité. L’homosexualité serait une alternative à l’hétérosexualité alors que la première dépend d’une identification partielle fondée sur un conflit psychique et que l’autre s’articule justement sur l’identité masculine ou féminine. Le reste des revendications s’en suit quasi automatiquement dans le sens où le mariage et l’enfant doivent relever des nécessités subjectives de chacun et non plus du sens du bien commun et de l’intérêt de l’enfant. La prétention à l’égalité des droits en ce domaine développe le sentiment de la suprématie à se satisfaire d’un seul sexe autosuffisant et hégémonique. Le sujet est ainsi dans le déni du manque en s’imaginant que tout est envisageable jusqu’à prendre possession par tous les moyens d’un enfant au détriment de ce qui le fonde et le structure objectivement. Une filiation établie juridiquement dans le cadre de la monosexualité est un acte intrinsèquement pervers dans le sens où elle est détournée d’une relation authentique partagée entre un homme et une femme. Seule leur union est l’avenir de l’humanité. Le problème soulevé ici au sujet de la pertinence du mariage et de l’adoption par des personnes homosexuelles, n’est pas celui de la personne homosexuelle qui n’a pas à être mise en cause, même si nous avons à nous interroger sur ce qu’est et sur ce que représente psychologiquement et anthropologiquement l’homosexualité, mais celui de vouloir redéfinir le couple, la conjugalité et la famille à partir de l’homosexualité et de l’imposer dans la loi : ce qui est structurellement et éthiquement antinomique et donc inauthentique. Le législateur fait perdre toute crédibilité à la loi lorsqu’il inscrit dans le code civil deux principes contradictoires dont l’un repose sur la différence objective de l’altérité sexuelle et l’autre dépend d’un désir qui ne représente aucun fondement possible au lien social. Il faut également souligner que l’homosexualité, quelle que soit son origine, n’est pas un droit que la Charte européenne proclame à tort, au nom de la non-discrimination, mais une singularité qui ne peut pas être à la source ni du couple, ni du mariage, ni de la parenté. Le langage et la loi civile peuvent tricher avec les réalités de la vie, cela ne change en rien les invariants humains qui, à un moment ou à un autre de l’histoire, se rappellent à la conscience universelle. La confusion des principes à ce sujet ne peut qu’obscurcir et fragiliser le cadre porteur de la société en déstabilisant le couple, le mariage et la famille qui ne sont pas à la libre disposition du législateur et du pouvoir politique pour en changer la nature. Ils ont la responsabilité de créer des lois en cohérence avec la nature altersexuelle du mariage et de la famille. Leur transgression favorise un tohu-bohu dans la différence des générations et insinue l’endogamie du même avec le semblable suscitant l’insécurité et accentuant la violence dans les relations humaines. Il suffit d’observer dans quel état moral se trouvent les pays développés lorsque des politiques se jouent des invariants humains. En France, le partenariat contractuel créé par le Pacte civil de solidarité (1999) a fait chuter le nombre des mariages. Un fait prévisible et qui fut annoncé en son temps. Le Pacs est à l’image de la précarité affective de l’époque actuelle et ne contribue pas à la paix sociale. Bien au contraire, il participe à la dissociation invisible des liens symboliques dont la société a besoin pour vivre. Le divorce, provoquant l’éclatement des familles du fait de la fragilité du couple, est une source profonde d’incertitude et de perte des repères structurants. Ils sont nombreux les enfants, issus de la mort de l’être familial, à établir, une fois devenus adultes, leur arbre généalogique afin de se situer dans la succession des liens charnels et de se reconnaître dans l’incarnation de leur filiation. Qu’en sera-t-il des enfants issus des techniques d’aide à la procréation et des enfants adoptés dans un contexte homosexuel qui seront les fils et les filles de personne, c’est-à-dire de la désincarnation et du déni de la différence sexuelle ? Comment pourront-ils trouver la réponse à leurs questions alors qu’ils seront enserrés dans l’unisexualité des adultes qui ne peuvent symboliser ni l’altérité sexuelle, ni la parenté. Ils apparaissent comme des frères ou des sœurs aînés sans sexe conjugal et sans être capables de les inscrire dans la différence des sexes et des générations. Ils jouent au papa et à la maman comme des enfants aliénés à leur complexe incestueux. Il n’y que dans les contes de fées et dans la psychose que les enfants naissent en dehors d’une expression sexuelle reprenant ainsi tous les fantasmes primaires de la procréation dans la psychologie enfantine. Le féminisme comme les revendications homosexuelles sont la traduction de l’idéologie de la désexualisation de la génération et du déni de la différence sexuelle ; un refus du donné corporel à partir duquel la vie survient. Le mépris du sexe charnel et de la rencontre intime de l’homme et de la femme en dit long sur la peur et le rejet qu’inspire l’enfermement dans l’unisexualité. Une filiation s’inscrivant en dehors des corps sexués de l’altérité masculine et féminine, est délirante. La vision idéologique du genre remplace le sexe par une sexualité construite uniquement socialement. Là aussi, au nom de la parité et de l’égalité on considère que tout est réalisable quelle que soit la condition dans laquelle chacun se trouve. Cette vision totalitaire de l’égalité est d’autant plus dommageable qu’elle ne s’articule plus sur la complémentarité des sexes qui régule et relativise un seul sexe qui risque de se prendre pour sa propre référence, mais sur le sentiment de toute-puissance d’un sexe qui aurait toutes les aptitudes. Deux personnes de même sexe sont dépourvues du pouvoir de la procréation entre-elles, de la symbolique qui se développe en extension à la génération, et d’une réelle relation éducative aux apports psychologiques structurants parce que complémentaires. Il est étrange de vouloir nier la différence sexuelle dans le couple, le mariage, la filiation et la parenté et de vouloir l’imposer là où elle n’est pas nécessaire dans divers secteurs de l’entreprise, de la vie sociale et politique. Il est également symptomatique de constater que plus la différence sexuelle est niée et plus le discours social fait l’éloge de la diversité. Notamment des diversités familiales qui ne seraient plus fondées sur la famille naturelle (couple homme/femme, liens du sang), mais aussi selon les désirs des uns et des autres et des situations dans lesquelles ils sont impliqués. Les séries télévisées exaltent tous ces cas particuliers largement minoritaires, mais dont on voudrait faire des références parmi d’autres alors que ce n’est pas ainsi que les gens vivent ou espèrent se réaliser. Il y a une différence profonde entre la famille naturelle et des situations singulières, voire accidentelles. Le mariage et la famille se définissent universellement à partir de l’alliance de l’homme et de la femme et non pas selon des cas particuliers qui, la plupart du temps, ne sont pas toujours structurants ni pour le sujet, ni pour le lien social. La société doit souvent soutenir ces cas particuliers et a raison de le faire, mais pour un coût financier, social et symbolique important. Les études montrent que le mariage est une source de sécurité et d’épanouissement lorsque les sujets savent élaborer les différentes étapes affectives. Il est également une source d’enrichissement économique pour les époux et pour la société alors que le divorce appauvrit la famille. Il revient donc à la loi de protéger l’enfant à disposer d’un père et d’une mère. Le sens du couple et de la famille inapplicable à l’homosexualité Nous ne pouvons pas faire l’impasse sur le sens du langage lorsque l’on applique à une association monosexuée, c’est-à-dire homosexuelle, les mêmes caractéristiques qu’une union constituée entre un homme et une femme. Il y a une différence de nature et de qualité qui met en jeu à la fois des composantes psychologiques incomparables et un sens éthique sans commune mesure. Ainsi la notion de couple et celle de famille n’ont rien à voir avec ces deux réalités. Deux personnes de même sexe (que je qualifie de duo2) sont dans une monosexualité dont l’altérité sexuelle et le couple générationnel sont absents. Elles ne forment ni un couple puisqu’il n’y a ni altérité, ni complémentarité, ni une famille puisque l’enfant ne résulte pas de deux personnes de même sexe. On ne conçoit pas un autre avec un même. Autrement dit, l’expression de l’amour implique la différence sexuelle pour être fertile et féconde à bien des égards, et l’enfant a besoin de procéder d’un homme et d’une femme pour s’inscrire dans la succession des générations et l’histoire, et être dans sa cohérence psychologique. Il lui est nécessaire de trouver des matériaux psychiques chez l’un et l’autre. Deux hommes ou deux femmes auprès d’un enfant le privent des données structurelles du réel ; ce qui aura un coût psychique et social. Le discours ambiant, comme je l’avais souligné dans mon livre La différence interdite (Flammarion), s’appuyant sur la théorie du genre qui minimise le sens de la différence sexuelle dans le lien social, produit des discours irréalistes et délirants en séparant la procréation de la différence sexuelle. Une telle segmentation de la sexualité est et sera source de violences dont on constate les effets auprès des plus jeunes. La violence qui se développe chez des jeunes est, entre autres, l’expression d’une carence du cadre porteur de la société qui est déstabilisé par des lois pathogènes. Autrement dit, le législateur en créant des lois contraires au bien commun, au sens éthique du couple et de la famille, et aux nécessités psychiques, rend malade le lien social et la société. Il crée un sentiment négationniste des réalités humaines structurantes, source d’insécurité et de désocialisation. C’est pourquoi, « l’homoparentalité », pour autant que cette notion ait un sens, est un mensonge social, l’enfant ne se conçoit ni ne s’éduque à partir d’un seul sexe. C’est le priver d’une dimension essentielle du réel que la présence des personnes de l’autre sexe dans son environnement social ne viendra pas compenser. L’enfant ne se développe positivement que dans la double identification à son père et à sa mère qui, faut-il le rappeler, sont un homme et une femme. Ils sont les seuls à lui apporter les matériaux psychiques et symboliques dont il a besoin pour se développer. L’indistinction sexuelle tout comme l’homosexualité ne peuvent en aucun cas inspirer des lois en matière conjugale et familiale à moins de voir se développer sur le long terme des confusions identitaires et des personnalités à caractère psychotique c’est-à-dire qui n’ont pas le sens des réalités et se maintiennent dans des postures imaginaires. Une société qui n’a pas le sens de la différence sexuelle, perd le sens de l’altérité, de la vérité et de la réalité des choses. Elle éclate dans des particularités singulières qui ne représentent aucun intérêt pour finaliser la société et ne participent en rien au développement de la personnalité. Dans le déni de la différence sexuelle et dans la complaisance de l’immaturité affective de l’indistinction sexuelle, elle ne sait plus faire les distinctions élémentaires et se dissout relationnellement. La vision monosexuelle de soi et de l’existence inscrite dans la loi est un véritable dissolvant social car elle ne témoigne pas de l’altérité sexuelle qui fonde à elle seule le mariage et la génération. La vie commence par la rencontre d’un homme et d’une femme. Leur relation est le symbole de l’ouverture à l’autre, à la génération et à la vie ; ouverture dont la société a besoin pour assurer le vivre ensemble et le respect du bien commun. L’enfant n’est pas un droit L’égalité des droits devant la loi ne signifie pas que toutes les situations se valent et que les personnes peuvent bénéficier des mêmes droits. Nous croyons de façon illusoire que plus un enfant est désiré et plus c’est un gage d’épanouissement pour lui. Certes, nous avons à veiller à la qualité du désir mais aussi et surtout à savoir si l’enfant est reconnu pour lui-même. Les interrogations sont parfois masquées derrière une vision sentimentale en nous assurant qu’il sera mieux « aimé » par des personnes homosexuelles qui le « désirent » que dans un couple qui se déchire relationnellement. Là n’est pas la question, mais davantage de savoir dans quelle structure relationnelle un enfant sera engagé. L’enfant ne peut pas être conçu et adopté dans n’importe quelles conditions. Au lieu de s’installer dans l’omnipotence des désirs, ne serait-il pas davantage plus humain, plus authentique et plus réaliste d’accepter d’y renoncer lorsque les exigences ne sont pas réunies plutôt que de chercher à forcer, voire même à violer le réel. La filiation ne se définit pas à partir de l’infertilité, de l’adoption et d’un seul sexe. C’est plutôt l’adoption qui doit se définir à partir d’un couple générationnel constitué d’un homme et d’une femme qui rend lisible l’origine dont l’enfant a besoin pour se repérer charnellement. Jusqu’à présent on avait raison d’exiger un critère de sexualité des célibataires pour adopter un enfant afin qu’il soit éduqué par des personnalités et dans un milieu où l’altérité sexuelle est intimement intégrée et acceptée. Il faudrait y revenir. L’enfant se différencie grâce à son père et à sa mère Quand on examine les motivations de personnes homosexuelles qui veulent un enfant, il apparaît qu’il n’est pas conçu pour lui-même, mais qu’il est instrumentalisé pour soutenir des adultes. Dans un contexte unisexué, l’enfant est plutôt le référant social qui sert à valider la reconnaissance de leur homosexualité. Il s’agit d’un phénomène de mimétisme afin d’être comme tout le monde. Pour un enfant, il est bien difficile de se différencier en étant pris dans un jeu d’identification en miroir sans ouverture sur l’altérité sexuelle puisque celle-ci n’existe pas intimement pour deux personnes de même sexe. Il risque de développer des confusions sur son origine, son identité et sur le sens de sa filiation qui est faussée avec deux semblables. L’enfant intègre mieux l’interdit œdipien dans un couple générationnel alors que l’une des composantes de l’homosexualité est liée, entre autres, au déni de ce complexe. La personnalité se maintient ainsi dans l’économie de la sexualité infantile. L’enfant peut mieux se reconnaître dans son identité et à sa place en se disant : « je suis une fille, je suis un garçon, et plus tard je serai un homme comme papa et une femme comme maman ». Discours difficilement tenable avec deux adultes de même sexe. L’unisexualité des adultes enferme dans un système de relation sans altérité qui mutile chez l’enfant de nombreuses dimensions du réel. L’acceptation, par exemple, de la différence sexuelle est l’une des premières limites que l’enfant rencontre à travers ses parents. Elle est inscrite dans le corps. Si je suis une fille, je ne peux pas être un garçon et réciproquement. Remettre en cause la parenté fondée sur la différence sexuelle revient à faire croire à l’enfant que ses désirs sont illimités. La reconnaissance par l’enfant de la différence sexuelle lui permet de former son intelligence et d’accéder à la capacité d’opérer les distinctions structurelles et conceptuelles. Il sera capable de distinguer le réel de l’imaginaire, la vérité des choses, leur cohérence et leur logique sans avoir à tricher avec les idées, à fausser le jugement, à manipuler les autres et les informations. Il en va de la vérité de sa filiation puisqu’un sujet s’organise, entre autres, psychologiquement à partir du sens de sa filiation et de l’intergénérationnel. Dans une relation monosexuelle, l’enfant ne dispose pas d’une réelle grand-parenté : elle sera souvent imaginaire et sans enracinement repérable. « L’homoparentalité » est une vision idéaliste de la parenté qui désincarne l’enfant. Une société qui transgresse les interdits majeurs et qui use de l’injonction paradoxale Un constat inquiétant s’impose en observant que le pouvoir politique restreint de plus en plus son action à vouloir légiférer non plus dans le sens de l’intérêt général et des enjeux régaliens, mais sur les mœurs, et ce, en contradiction avec la liberté des citoyens, avec les structures fondatrices du couple, du mariage et de la famille et avec les droits et les intérêts des enfants. Le législateur déstabilise ainsi le cadre porteur de la société en instituant dans les lois des transgressions majeures. La société repose sur des interdits structurants comme la prohibition de l’inceste et du meurtre, le respect de la différence des sexes et des générations. Face à ces interdits qui favorisent la vie, le législateur exprime des injonctions paradoxales car à la fois il rappelle l’interdit du meurtre et crée des dérogations particulières pour supprimer des enfants en gestation à travers l’avortement, pour faire des expériences sur des embryons, et rétablir l’eugénisme avec le DPI (diagnostic préimplantatoire) visant à supprimer les embryons présentant un risque de malformation jusqu’à la trisomie 21. Il va agir de la même façon avec la différence sexuelle en affirmant que le mariage scelle l’institution conjugale entre un homme et une femme tout en créant un contrat de partenariat (forme d’union civile) en lui attribuant les mêmes droits que le mariage, sauf la filiation dans certains pays. Dans de nombreux États, des lois d’exception sont votées qui tentent de contourner l’édifice législatif concernant la famille afin de permettre à des personnes homosexuelles d’adopter des enfants. Le statut du « beau-parent » dont on parle en France, est symptomatique du morcellement du sens de la famille et témoigne du manque de vision anthropologique des responsables politiques. Ils sont largement influencés par des idéologies sociologisantes qui théorisent sur des phénomènes particuliers et minoritaires pour les ériger en références possibles. Pendant ce temps, se multiplient des lois qui opèrent des transgressions majeures masquées par des injonctions paradoxales, celles-là mêmes qui sont habituellement utilisées par des personnalités perverses qui finissent par faire perdre l’entendement à ceux qu’ils manipulent. Il est étrange d’observer que plus la société s’éloigne des interdits majeurs et plus elle multiplie des interdits de circonstances et crée des « hautes autorités de l’égalité », véritables ministères des bonnes mœurs, en contrôlant et en pénalisant, par exemple, le langage pour éviter l’usage de certains termes, en luttant contre la discrimination là où des différences sont quand même marquées et en imposant une parité tout en négligeant ce qui fonde la différence et l’altérité : la différence sexuelle. L’homosexualité n’est pas un principe pour éduquer les enfants Les médias et les militants des associations homosexuelles se donnent même le pouvoir de banaliser l’homosexualité dans de nombreuses séries télévisées et dans des débats qui font l’impasse sur la problématique psychique qui est en jeu, et de la propager dans les écoles. Une chose est d’en appeler à respecter les personnes, une autre est de permettre le mariage et la filiation à des personnes de même sexe ; voire d’imposer l’homosexualité auprès des enfants et des adolescents dans le cadre scolaire. Les jeunes sont souvent dans des périodes de maturation affective et dans le dénouement de leur identification homosexuée (qui n’est pas encore l’homosexualité) pour acquérir de la confiance dans leur identité. Au lieu de les aider à s’acheminer vers l’hétérosexualité, on leur présente l’homosexualité comme une alternative, ce qu’elle n’est pas, qui les renvoie à une régression en érotisant leurs identifications premières. La plupart des jeunes ressortent de ces séances en masquant leur sentiment de révolte d’être ainsi manipulés car ils savent bien qu’on veut les entraîner sur un terrain qui ne représente pas un réel accomplissement affectif. Les médias et les militants de cette cause sont perçus comme ceux qui veulent justifier à tout prix une situation dont la base est problématique. Pour les enfants et les adolescents, un couple et une famille, c’est un homme et une femme. Le reste est une duperie sociale et une affaire de convenance qui est étrangère au mariage et à la parenté. L’école devient ainsi l’enjeu d’influences idéologiques sous le prétexte de la lutte contre « l’homophobie », ce qui est un prétexte pour imposer une singularité et déposséder les parents de leur éducation. L’homosexualité ne peut pas devenir un principe éducatif puisqu’elle est à la marge de la norme de ce qui constitue un couple et une famille. Les enfants et les adolescents ont déjà du mal à se représenter ce que peut être la vie sexuelle entre un homme et une femme, la situation est davantage compliquée lorsqu’il s’agit de deux personnes de même sexe. D’ailleurs les enfants perçoivent bien qu’il y a une incohérence entre le fait d’être parents et la façon d’exercer sa sexualité. Autrement dit, l’adoption des enfants exige un critère de sexualité afin que leur vie soit confiée à des adultes qui sont dans la même situation que pour concevoir un enfant entre un homme et une femme. C’est pourquoi l’école se doit surtout de tenir compte de la primauté du sens du couple et de la famille fondés par un homme et une femme. Conclusion : Il est dans l’intérêt de la société de se référer à la différence sexuelle au lieu de s’installer dans l’indistinction sexuelle La négation de la différence sexuelle et l’affirmation de l’indistinction sexuelle développent un sentiment de toute-puissance handicapant qui empêche l’enfant d’accéder à une vision juste de la réalité et de ses limites. La seule question qui se pose est de savoir dans quelle structure relationnelle l’enfant doit s’inscrire ? La réponse est dans le donné du réel. L’enfant ne procède pas d’un seul sexe auto-suffisant. Il a besoin que sa mère soit une femme et son père un homme. Chacun est ainsi situé dans son identité et permet à l’enfant de se différencier subjectivement et socialement. L’homosexualité complique et ne permet pas ces processus. Elle est une singularité personnelle fondée sur une sexualité étrangère à la conception, à la transmission de la vie et à l’éducation des enfants. Il n’y a pas d’altérité sexuelle dans la vie intrapsychique des adultes avec lesquels un enfant partage son existence. Socialement elle n’est pas une différence comme on le prétend, elle est la négation de toutes les différences conjugales et parentales. On ne peut donc pas définir rationnellement la parenté et la filiation simple ou plénière, et encore moins l’éducation des enfants à partir de l’homosexualité, quelle qu’en soit l’origine, sous le seul prétexte d’un hypothétique bien être affectif. Les droits et l’intérêt de l’enfant sont premiers face aux exigences subjectives des adultes. L’intérêt de l’enfant est d’être engagé dans une relation qui s’inscrit dans la continuité de sa conception entre un homme et une femme. Le droit et l’intérêt de l’enfant sont les critères de discernement qui viennent limiter le droit à l’enfant des adultes. Mgr Tony ANATRELLA Rome le 10 février 2010 1 Psychanalyste et spécialiste en psychiatrie sociale. Enseignant aux Facultés libres de philosophie et de psychologie de Paris (IPC) et au Collège des Bernardins (Paris) Consulteur du Conseil Pontifical pour la Famille et du Conseil Pontifical pour la Pastorale de la Santé. Auteur sur le même sujet de : La différence interdite, Flammarion. Époux, heureux époux, Flammarion. Le règne de Narcisse, Presses de la Renaissance. La tentation de Capoue - Anthropologie du mariage et de la filiation - Cujas. 2 Anatrella Tony, Époux, heureux époux, Paris, Flammarion Zenit.org, 2006. Tous droits réservés - Pour connaitre les modalités d´utilisation vous pouvez consulter : www.zenit.org ou contacter infosfrench@zenit.org - Pour recevoir les news de Zenit par mail vous pouvez cliquer ici |