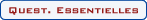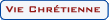12 décembre 2025 -
Ste Jeanne de Chantal
12 décembre 2025 -
Ste Jeanne de Chantal
Publié le : 17 janvier 2008 Source : Zenit.org
Les newsDiscours que le pape aurait dû prononcer à « La Sapienza » de Rome (I)ROME, Jeudi 17 janvier 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous la première partie du discours que le pape Benoît XVI avait préparé pour sa visite à l’Université « La Sapienza » de Rome. Cette visite a été annulée en raison des protestations d’un petit groupe d’enseignants et d’étudiants. Monsieur le Recteur Magnifique, Mesdames et Messieurs les Représentants des Autorités politiques et civiles, Illustres professeurs et membres du personnel technique et administratif, Chers jeunes étudiants ! C’est pour moi un motif de profonde joie de rencontrer la communauté de la « Sapienza - Université de Rome », à l’occasion de l’inauguration de l’Année académique. Depuis désormais plusieurs siècles cette Université marque le chemin et la vie de la ville de Rome, en faisant fructifier les meilleures énergies intellectuelles dans tous les domaines du savoir. Que ce soit à l’époque où, après sa fondation voulue par le Pape Boniface VIII, l’institution dépendait directement de l’Autorité ecclésiastique, ou successivement, lorsque le Studium Urbis s’est développé comme institution de l’Etat italien, votre communauté universitaire a conservé un haut niveau scientifique et culturel, qui l’inscrit parmi les universités les plus prestigieuses du monde. L’Eglise de Rome regarde depuis toujours avec sympathie et admiration ce centre universitaire, reconnaissant son engagement, parfois difficile et laborieux, pour la recherche et la formation des nouvelles générations. Ces dernières années, des moments significatifs de collaboration et de dialogue n’ont pas manqué. Je voudrais rappeler, en particulier, la rencontre mondiale des Recteurs à l’occasion du Jubilé des Universités, qui a vu votre communauté prendre en charge non seulement l’accueil et l’organisation, mais surtout la proposition prophétique et complexe de l’élaboration d’un « nouvel humanisme pour le troisième millénaire ». J’ai à cœur, en cette circonstance, d’exprimer ma gratitude pour l’invitation qui m’a été adressée à venir dans votre université pour y tenir une leçon. Dans cette perspective, je me suis tout d’abord posé la question : que peut et que doit dire un Pape en une occasion comme celle-ci ? Dans ma leçon à Ratisbonne, j’ai parlé, bien sûr, en tant que Pape, mais j’ai surtout parlé en qualité d’ancien professeur de cette université, en cherchant à relier les souvenirs et l’actualité. A l’Université la « Sapienza », l’antique université de Rome, je suis cependant invité en tant qu’Evêque de Rome, et je dois donc parler comme tel. Certes, la « Sapienza » était autrefois l’Université du Pape, mais aujourd’hui c’est une université laïque avec cette autonomie qui, à partir de son concept même de fondation, a toujours fait partie de l’université, qui doit exclusivement être liée à l’autorité de la vérité. Dans sa liberté à l’égard de toute autorité politique et ecclésiastique, l’université trouve sa fonction particulière, précisément aussi pour la société moderne, qui a besoin d’une institution de ce genre. Je reviens à ma question de départ : que peut et que doit dire le Pape au cours de la rencontre avec l’université de sa ville ? En réfléchissant à cette question, il m’a semblé qu’elle en contenait deux autres, dont la clarification devrait toute seule conduire à la réponse. En effet, il faut se demander : quelle est la nature de la mission de la papauté ? Et encore : Quelle est la nature de la mission de l’université ? Je ne voudrais pas, en ce lieu, vous retenir par de longs discours sur la nature de la papauté. Une brève explication suffira. Le Pape est tout d’abord l’évêque de Rome et, comme tel, en vertu de la succession à l’Apôtre Pierre, il possède une responsabilité épiscopale à l’égard de l’Eglise catholique tout entière. Le terme « évêque-episkopos », qui dans sa première signification renvoie à l’idée de « surveillant », a déjà été fondue dans le Nouveau Testament avec le concept biblique de Pasteur : il est celui qui, d’un point d’observation surélevé, regarde l’ensemble, en prenant soin du bon chemin et de la cohésion de l’ensemble. C’est pourquoi cette définition de sa tâche oriente tout d’abord le regard vers l’intérieur de la communauté des croyants. L’Evêque - le Pasteur - est l’homme qui prend soin de cette communauté ; celui qui la conserve unie en la gardant sur le chemin vers Dieu, indiqué selon la foi chrétienne par Jésus - mais pas seulement indiquée : Il est lui-même le chemin pour nous. Mais cette communauté dont l’Evêque prend soin - qu’elle soit grande ou petite - vit dans le monde ; ses conditions, son chemin, son exemple et sa parole influent inévitablement sur tout le reste de la communauté humaine dans son ensemble. Plus celle-ci est grande, plus ses bonnes conditions ou sa dégradation éventuelle se répercuteront sur l’ensemble de l’humanité. Nous voyons aujourd’hui très clairement de quelle manière les conditions des religions et la situation de l’Eglise - ses crises et ses renouvellements - agissent sur l’ensemble de l’humanité. C’est pourquoi le Pape, précisément comme Pasteur de sa communauté, est également devenu toujours plus une voix de la raison éthique de l’humanité. Une objection apparaît cependant immédiatement ici, selon laquelle le Pape, de fait, ne parlerait pas vraiment sur la base de la raison éthique, mais tirerait ses jugements de la foi et ne pourrait donc pas prétendre qu’ils soient valables pour ceux qui ne partagent pas cette foi. Nous devrons encore revenir sur ce thème, car c’est la question absolument fondamentale qui est posée là : qu’est-ce que la raison ? Comment une affirmation - surtout une norme morale - peut-elle se démontrer « raisonnable » ? A ce point, je ne voudrais pour le moment que brièvement observer que John Rawls, bien que niant à des doctrines religieuses compréhensives le caractère de la raison « publique », voit toutefois dans leur raison « non publique » au moins une raison qui ne pourrait pas, au nom d’une rationalité endurcie par le sécularisme, être simplement méconnue par ceux qui la soutiennent. Il voit un critère de cet aspect raisonnable, entre autres, dans le fait que de telles doctrines dérivent d’une tradition responsable et motivée, dans lesquelles au cours des temps ont été développées des argumentations suffisamment valables pour soutenir la doctrine relative. Dans cette affirmation, il me semble important de reconnaître que l’expérience et la démonstration au cours de générations, le fond historique de la sagesse humaine, sont également un signe de son caractère raisonnable et de sa signification durable. Face à une raison a-historique qui cherche à se construire toute seule uniquement dans une rationalité a-historique, la sagesse de l’humanité comme telle - la sagesse des grandes traditions religieuses - est à valoriser comme une réalité que l’on ne peut pas impunément jeter au panier de l’histoire des idées. Revenons à la question de départ. Le Pape parle comme le représentant d’une communauté de croyants dans laquelle, au cours des siècles de son existence, a mûri une sagesse déterminée de la vie ; il parle comme le représentant d’une communauté qui conserve en soi un trésor de connaissance et d’expérience éthiques, qui est important pour l’humanité tout entière : en ce sens, il parle comme le représentant d’une raison éthique. Mais on doit alors se demander : qu’est-ce que l’université ? C’est une question immense, à laquelle, encore une fois, je ne peux chercher à répondre qu’en style presque télégraphique, en effectuant quelques observations. Je pense que l’on peut dire que la véritable origine profonde de l’université se trouve dans la soif de connaissance qui est propre à l’homme. Il veut savoir ce qu’est tout ce qui l’entoure. Il veut la vérité. C’est dans ce sens que l’on peut voir l’interrogation de Socrate comme l’impulsion à partir de laquelle est née l’université occidentale. Je pense, par exemple - pour ne mentionner qu’un texte - au dialogue avec Euthyphron, qui, face à Socrate défend la religion mythique et sa dévotion. Socrate oppose à ce point de vue la question suivante : « Tu crois sérieusement qu’entre les dieux il y a des querelles, des haines, des combats... Euthyphron, devons-nous recevoir toutes ces choses comme bonnes ? » (6 b - c). Dans cette question apparemment peu pieuse - qui chez Socrate dérivait cependant d’une religiosité plus profonde et plus pure, de la recherche du Dieu vraiment divin - les chrétiens des premiers siècles se sont reconnus eux-mêmes, ainsi que leur chemin. Ils n’ont pas accueilli leur foi de manière positiviste, ou comme une issue à des désirs non satisfaits ; ils l’ont comprise comme la dissipation du brouillard de la religion mythologique, pour faire place à la découverte de ce Dieu qui est Raison créatrice et, dans le même temps, Raison-Amour. C’est pourquoi, l’interrogation de la raison sur le Dieu le plus grand, ainsi que sur la véritable nature et le véritable sens de l’être humain n’était pas pour eux une forme problématique de manque de religiosité, mais faisait partie de l’essence de leur façon d’être religieux. Ils n’avaient donc pas besoin de répondre à l’interrogation socratique, ou de la mettre de côté, mais ils pouvaient et devaient même accueillir et reconnaître comme une partie de leur identité la recherche difficile de la raison, pour parvenir à la connaissance de la vérité tout entière. C’est ainsi que pouvait et devait même naître dans le cadre de la foi chrétienne, dans le monde chrétien, l’université. Il est nécessaire d’accomplir un pas supplémentaire. L’homme veut connaître, il veut la vérité. La vérité est avant tout un élément en relation avec le fait de voir, de comprendre, avec la theoría, comme l’appelle la tradition grecque. Mais la vérité n’est jamais seulement théorique. Augustin, en établissant une corrélation entre les Béatitudes du Discours sur la Montagne et les dons de l’Esprit mentionnés dans Isaïe 11, a affirmé une réciprocité entre « scientia » et « tristitia » : le simple savoir, dit-il, rend triste. Et de fait - celui qui voit et qui apprend seulement tout ce qui a lieu dans le monde, finit par devenir triste. Mais la vérité signifie davantage que le savoir : la connaissance de la vérité a pour objectif la connaissance du bien. Tel est également le sens de l’interrogation socratique : quel est le bien qui nous rend vrais ? La vérité nous rend bons, et la bonté est vraie : tel est l’optimisme qui est contenu dans la foi chrétienne, car à celle-ci a été accordée la vision du Logos, de la Raison créatrice qui, dans l’incarnation de Dieu, s’est en même temps révélée comme le Bien, comme la Bonté elle-même. © Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican Zenit.org, 2006. Tous droits réservés - Pour connaitre les modalités d´utilisation vous pouvez consulter : www.zenit.org ou contacter infosfrench@zenit.org - Pour recevoir les news de Zenit par mail vous pouvez cliquer ici |