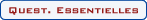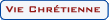16 décembre 2025 -
Sainte Adélaïde
16 décembre 2025 -
Sainte Adélaïde
Publié le : 5 septembre 2006 Source :
Les newsTextes des interventions prononcées par Mgr Vingt-Trois et M. Delanoë lors de l’inauguration du parvis Jean-Paul IIIntervention de Mgr Vingt-TroisQuel parisien pourra jamais oublier la douceur de cet après-midi de la fin du mois de mai 1980, quand le Pape Jean-Paul II est arrivé pour la première fois sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris ? Qui oubliera jamais l’accent granitique du cardinal Marty accueillant celui auquel il donnera le surnom « d’athlète de Dieu », accent qui contrastait si bien avec le doux chatoiement de la façade dorée de la cathédrale ? Quel parisien, quel français, pourrait oublier ce premier voyage pontifical et son leitmotiv formulé lors de la Messe au Bourget : « France, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? » ? Il fallait à certains commentateurs quelque naïveté, -mais était-elle toujours innocente ?- pour imaginer que le Pape ignorait qu’il ne s’adressait pas à une nation entièrement chrétienne ou qu’il rêvait que le baptême pouvait être le fait d’un peuple et non pas d’une personne. C’est très consciemment et très délibérément qu’il parlait à la France comme à une personne. Il savait que, comme une personne, elle était tiraillée par toutes sortes de contradictions. Mais il savait aussi, -et son discours à l’UNESCO en sera le témoignage éclatant-, que la culture constitue un peuple comme un sujet particulier, et que toute culture s’identifie par les valeurs qui l’ont fondée et qui lui ont fourni son socle. Pour la France, qui peut douter que ces valeurs ont été d’abord et principalement chrétiennes, y compris dans leurs développements sécularisés ? L’adhésion personnelle aux valeurs fondatrices est naturellement inégale et variable pour chacun et selon les périodes de la vie, mais le fonds des références, lui, est identifiable et accessible à tout esprit de bonne volonté. Notre cathédrale n’est-elle pas une bonne allégorie de cette approche des valeurs fondatrices de notre culture nationale ? Ni son architecture incomparable ni son usage quotidien pour la prière chrétienne ne peuvent laisser le moindre doute sur la nature de cet édifice. C’est une église catholique. Elle a été conçue et construite pour être la principale église du diocèse de Paris. Aujourd’hui encore elle en est l’église mère. Et pourtant, sans parler des millions de touristes qui la visitent comme un lieu spécifique, quel parisien, quel français, ne se reconnaîtrait un lien particulier avec cette église, quelles que soient pas ailleurs ses convictions ou sa foi religieuse ? N’est-elle pas un élément vivant de notre mémoire nationale et de notre patrimoine culturel commun ? Mais le patrimoine culturel, comme tout patrimoine, n’est identifié et reconnu que dans la mesure où il est aujourd’hui une force vivante. C’est notre mission de chrétiens de donner corps à cette richesse dans les conditions de la vie actuelle. La forte identité de ces lieux, en même temps que leur ouverture à tout esprit humain épris de droiture et de justice, nous aident à comprendre quelque chose de l’attachement des hommes droits à la personne de Jean-Paul II. A travers sa présence de plus d’un quart de siècle sur les continents de notre univers comme à travers ses innombrables discours, les hommes de bonne volonté, bien au-delà des fidèles catholiques, ont pu reconnaître, dans la proclamation sans concession de la foi chrétienne, une parole d’espérance qui rejoint le cœur humain, plus profondément que les appartenances politiques, idéologiques ou même religieuses, une parole qui révèle l’homme à lui-même, qui lui fait pressentir sa plus haute dignité. Ainsi, devant cette cathédrale, Jean-Paul II interrogeait-il, prolongeant la question de Jésus à Pierre : « Aimes-tu ». Et il commentait : « C’est la question qui ouvre le cœur - et qui donne son sens à la vie. C’est la question qui décide de la vraie dimension de l’homme. En elle c’est l’homme tout entier qui doit s’exprimer et qui doit aussi, en elle, se dépasser lui-même » (1). L’émotion ressentie au moment de sa mort, les foules qui se sont pressées, ici même sur ce parvis et dans toutes les églises de la capitale, disaient assez une gratitude profonde envers un homme dans lequel la plupart ont reconnu une voix ajustée à nos temps troublés, une voix qui fait espérer que dans l’histoire de l’humanité, se construit le monde du bien. Ici même, le Pape disait : « L’amour seul construit un tel monde. Il le construit avec peine. Il doit lutter pour lui donner forme ». Paris a eu l’honneur d’accueillir deux fois Jean-Paul II. La première fois en 1980, la seconde fois pour les Journées Mondiales de la Jeunesse en 1997. Chacun de ces deux voyages a marqué un tournant, non seulement pour les catholiques, mais pour tous nos compatriotes. Peut-on dire que l’air n’était plus tout à fait le même et que l’atmosphère avait changé ? Les historiens le diront. Ils ont commencé de le dire. Ce quart de siècle a certainement été marqué par des changements profonds dans le monde, en Europe, en France, et, donc à Paris, changements auxquels Jean-Paul II a pris une part considérable que chacun connaît. Ces changements ont touché nos communautés catholiques. Ils touchent tout notre pays. En mémoire des événements vécus avec Jean-Paul II en notre ville de Paris et en mémoire du rayonnement exceptionnel de sa personnalité, j’ai donc été très sensible, Monsieur le Maire, à votre projet de donner le nom de Jean-Paul II à un lieu de la capitale. Et quel lieu pouvait mieux convenir que celui où nous sommes ? Quel lieu, mieux que celui-ci, pouvait symboliquement réunir et la tradition vivante de la foi chrétienne et la mémoire de notre patrimoine national et le brassage des peuples et des croyances de l’univers ? Quel lieu, mieux que celui-ci, pouvait exprimer cette rencontre des fondements de notre culture et des interrogations de notre temps présent ? Pour terminer, comment ne pas reprendre encore quelques phrases de Jean-Paul II lors de sa réception officielle par Maire de Paris à l’Hôtel de Ville. Ayant salué Paris « ville lumière » et « une des capitales du monde », sans négliger les questions concrètes du présent et les « multiples problèmes d’aménagement, d’organisation, qui sont le lot des grandes métropoles » soucieuses de l’avenir, Jean-Paul II poursuivait : « Paris, c’est d’abord des hommes, des femmes, des personnes entraînées par le rythme rapide du travail dans les bureaux, les lieux de recherche, les magasins, les usines ; une jeunesse en quête de formation et d’emploi ; des pauvres aussi, qui vivent souvent leur détresse, ou même leur indigence, avec une dignité émouvante, et que nous ne pouvons jamais oublier ; un va-et-vient incessant de population souvent déracinée ; des visages anonymes où se lit la soif de bonheur, du mieux-être et, je le crois aussi, la soif du spirituel, la soif de Dieu » (2). La béatification de Frédéric Ozanam, célébrée dans cette cathédrale pendant les Journées Mondiales de la Jeunesse de 1997, a ajouté un nom aux saints de notre ville. Frédéric Ozanam est un bel exemple et un noble compagnon pour tous ceux qui, ici et ailleurs, sont sensibles à la condition de ceux qui les entourent et veulent engager leurs forces et leur jeunesse dans le service de leurs frères. Après que vos prédécesseurs ont donné le nom de Jean XXIII au jardin qui borde la cathédrale, je vous remercie, vous-même, Monsieur le Maire, et le Conseil de Paris, de donner à son parvis le nom de Jean-Paul II. +André Vingt-Trois Discours de Bertrand DelanoëMonseigneur le Nonce apostolique, Il y a un an et demi, à l’annonce de la mort du pape Jean-Paul II, de très nombreux Parisiens se sont rassemblés sur ce parvis. Leur élan n’exprimait pas seulement l’ardeur d’une foi. D’évidence, ce deuil, dépassant la seule conscience catholique, prenait aussi la forme d’un hommage à une figure essentielle de notre temps. Ensemble, ils célébraient sa clairvoyance active, érigée, tel un rempart, contre les dérives intégristes qui menacent. Cet hommage, nous l’exprimons aujourd’hui, en cohérence avec l’identité de Paris, nourrie depuis toujours d’une diversité féconde. En effet, les noms des rues et des places de notre ville, sont le meilleur symbole de cette multiplicité d’héritages qui forgent notre histoire commune. On y trouve la trace de celui qui croyait au ciel, de celui qui n’y croyait pas, et même de celui qui y croyait à sa façon. Si notre ville n’oublie pas ce qu’elle doit à la part chrétienne de son histoire, elle a toujours honoré des femmes et des hommes dont la variété des engagements intellectuels et spirituels, dessine une constellation magnifique. Jean-Paul II la rejoint à présent, lui, l’acteur épris de liberté, le combattant de la vérité, l’homme de la paix. Ainsi, il contribua à ouvrir les premières brèches dans le rideau de fer, en accompagnant la lutte des peuples d’Europe de l’est vers la reconquête obstinée de leur liberté. Sans doute ses propres racines expliquent-elles le rapport spécifique de Jean-Paul II au monde. Issu du cœur d’un peuple asservi à deux reprises par le totalitarisme, il mesurait d’autant mieux le sens profond et la valeur infinie de la liberté. Sur les ravages des Croisades, sur les violences de l’Inquisition, sur la haine stérile des guerres de religion, sur l’indifférence parfois complice de certaines autorités catholiques devant la traite des Noirs, il aborda avec un courage exceptionnel toutes les facettes de cet héritage. « Nous avons tous commis des fautes » disait-il, et il ajoutait : « L’Eglise a le devoir de regretter profondément les faiblesses de tant de ses fils qui ont défiguré son visage ». Mais là ne s’arrête pas le legs de Jean-Paul II. Car mieux que d’autres, il invita le monde à capter cette richesse qui réside dans les interprétations multiples de la vie, dans la façon d’en rechercher le sens. C’est pour cela aussi que son message portait tant auprès des non croyants. Et avec tous les cultes, dont je salue ici les représentants, Jean-Paul II a engagé un dialogue fraternel et confiant. Resurgit ici l’image saisissante de la grande rencontre d’Assise, où l’on vit le pape de Rome entouré de bouddhistes, d’hindouistes, de musulmans, de juifs et bien sûr, de toutes les familles chrétiennes. Après une visite inédite à la synagogue de Rome, il se rendit en Israël, dont il fut le premier pape à reconnaître l’existence, tout en manifestant d’ailleurs, un soutien constant au désir de vivre du peuple palestinien. Il osa rappeler que Jésus était juif, que Marie était juive, et que le christianisme tirait sa sève « de la racine de ce bon olivier ». Ainsi, il ôta toute prise à l’expression d’un antisémitisme chrétien. Pour combattre la peur de la différence, il consacra aussi d’inlassables efforts à bâtir des ponts entre le christianisme et l’islam. C’est en cela que sa marque dépasse un cadre strictement spirituel, pour s’imprimer dans le champ beaucoup plus vaste de l’humain. Ainsi, sur le respect de toutes les identités, sur les droits des femmes, sur les choix de vie, sur le devoir aussi de protéger sa propre existence et celle d’autrui, j’ai regretté publiquement que l’autorité morale de Jean-Paul II ne soit pas mise au service d’avancées attendues et même espérées. Là où se côtoient déjà tant de noms célèbres, de destins singuliers, avec leurs contrastes et leurs paradoxes, mais surtout leur apport à notre vie collective, à ce que nous sommes ensemble. C’est aussi pour cela que l’identité de Paris est unique et qu’elle dépasse nos consciences individuelles. Puisse le nom de Jean-Paul II, désormais inscrit en ce lieu, maintenir intactes notre vigilance, notre tolérance, notre courage et surtout notre capacité à nous enrichir des autres. Source : Site du diocèse de Paris http://catholique-paris.cef.fr/ |