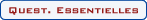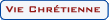1er septembre 2025 -
Saint Gilles
1er septembre 2025 -
Saint Gilles
Publié le : 5 août 2006 Source : Diocèse de Paris
Les newsContribution de Mgr Vingt-Trois sur la bioéthiqueL’Église catholique ne s’exprime pas d’abord ni exclusivement en raison de pratiques ou d’interdits religieux particuliers mais au nom d’une conception de l’homme. Ce qu’elle a à dire en matière de bioéthique et de recherches médicales est, certes, fondé sur le Décalogue et notamment le « Tu ne tueras pas ». Ces commandements, en se combinant avec la sagesse grecque, ont façonné notre civilisation occidentale. Ils sont intégrés à notre conscience collective. L’Occident y a reconnu l’expression de la raison humaine et de la dignité propre à tout homme qu’aucune discrimination ne peut réduire. Par ailleurs, l’Église catholique encourage vivement la médecine, ses progrès et les recherches qu’ils exigent. Sans remonter trop en arrière, notons ici l’enseignement du Pape Pie XII sur beaucoup de questions d’éthique médicale. Les progrès considérables réalisés depuis le XVIIIème siècle ont fait entrer la médecine dans une ère nouvelle. Elle mobilise des moyens considérables et elle peut s’attaquer à des maladies qui paraissaient jusque-là une fatalité . La fascination qu’exerce ces progrès de la médecine ne doit pas occulter les critères moraux et conduire à des pratiques qui blessent la dignité humaine, notamment en matière d’expérimentation. Des protocoles précis ont été établis pour que les essais nécessaires soient faits sur des animaux (ils ne sont d’ailleurs pas forcément sans poser des questions éthiques eux aussi) et pour que le passage à l’expérimentation humaine se fasse lorsque les espoirs d’efficacité d’un produit ou d’une intervention sont suffisamment sérieux et toujours avec l’accord informé des sujets. En matière de recherche génétique, l’Église invite à respecter ces règles avec rigueur, tout manquement à la dignité d’un être humain étant une atteinte à la dignité de tous. Il n’est pas inutile de se souvenir de l’aventure du Professeur coréen Hwang. Si la révélation de ses fraudes ne doit évidemment pas ruiner toute confiance dans les chercheurs, cette aventure est un avertissement : la recherche sur les gènes suscite des espoirs immenses qui finissent par devenir insensés voire fantasmatiques. Ils exercent une telle fascination que nombreux sont ceux qui perdent la tête. Pour obtenir les fonds nécessaires à des travaux extrêmement laborieux et coûteux, certains utilisent les attentes des malades potentiels que nous sommes comme moyen de pression sur les gouvernements et les donateurs. La concurrence entre les pays exacerbe aussi cette course aux financements, la crainte que son pays se trouve à la remorque des autres étant un argument facilement exploitable. Dans ce contexte, le rôle des hommes politiques est de garder la tête froide et d’aider aussi bien les chercheurs que les particuliers à réfléchir à long terme. A l’heure qu’il est, trois faits peuvent être rappelés :
Par ailleurs, émerge une interrogation légitime : jusqu’à quelle mesure peut-on mobiliser des fonds considérables à des programmes de recherche extrêmement coûteux, dont les éventuels résultats positifs ne pourront jamais être exploitables à grande échelle, tandis que manquent les médicaments nécessaires pour soigner ou prévenir des maladies extrêmement répandues dont l’éradication est moins une question de recherche que de moyens financiers et de volonté politique ? De manière plus générale, le Président de la République a pris l’engagement solennel le 8 février 2001 devant le Forum mondial des biotechnologies à Lyon de refuser tout clonage humain. Cette position a fait l’honneur de la France. Une position semblable bien que moins nette a été adoptée par l’ONU en sa sixième commission le 18 février 2005, confirmée par l’Assemblée générale le 8 mars suivant. La récente loi de bioéthique dont les décrets d’application viennent tout juste de paraître a introduit des accommodements pour une période limitée à 5 ans. Ces accommodements doivent faire l’objet d’une évaluation. Quoi qu’il en soit des pressions exercées par certains scientifiques inquiets de ne pouvoir se lancer dans les mêmes recherches que ceux d’autres pays, la France n’aurait-elle pas tout intérêt à promouvoir des programmes de recherche de haut niveau, visant à l’excellence, dans le domaine des cellules souches adultes ? Cela serait bien dans son rôle de promotion des droits de l’homme et de son souci que tous les hommes reçoivent les mêmes droits, sans aucune discrimination. En tout cas, la confiance que les citoyens mettent dans les institutions démocratiques ne peut que souffrir de voir remis en cause, à peine instaurés, des équilibres délicats en matière de mours et de vie sociale. L’Église a confiance à la fois dans les ressources du vivant et dans l’ingéniosité des scientifiques pour trouver des voies de progrès médical dans le plus strict respect de la dignité humaine. Les crises sanitaires récentes nous montrent que, si certaines maladies régressent, d’autres apparaissent dans le même temps. Que la vie humaine puisse se développer à l’abri de toute maladie est un rêve hélas illusoire. A une époque où beaucoup est possible et où les moyens dont l’humanité dispose sont à la fois immenses et limités, c’est la fonction du politique que d’indiquer aux scientifiques le cadre humain dans lequel leurs recherches peuvent se développer. Par ailleurs, émerge une interrogation légitime : jusqu’à quelle mesure peut-on mobiliser des fonds considérables à des programmes de recherche extrêmement coûteux, dont les éventuels résultats positifs ne pourront jamais être exploitables à grande échelle, tandis que manquent les médicaments nécessaires pour soigner ou prévenir des maladies extrêmement répandues dont l’éradication est moins une question de recherche que de moyens financiers et de volonté politique ? De manière plus générale, le Président de la République a pris l’engagement solennel le 8 février 2001 devant le Forum mondial des biotechnologies à Lyon de refuser tout clonage humain. Cette position a fait l’honneur de la France. Une position semblable bien que moins nette a été adoptée par l’ONU en sa sixième commission le 18 février 2005, confirmée par l’Assemblée générale le 8 mars suivant. La récente loi de bioéthique dont les décrets d’application viennent tout juste de paraître a introduit des accommodements pour une période limitée à 5 ans. Ces accommodements doivent faire l’objet d’une évaluation. Quoi qu’il en soit des pressions exercées par certains scientifiques inquiets de ne pouvoir se lancer dans les mêmes recherches que ceux d’autres pays, la France n’aurait-elle pas tout intérêt à promouvoir des programmes de recherche de haut niveau, visant à l’excellence, dans le domaine des cellules souches adultes ? Cela serait bien dans son rôle de promotion des droits de l’homme et de son souci que tous les hommes reçoivent les mêmes droits, sans aucune discrimination. En tout cas, la confiance que les citoyens mettent dans les institutions démocratiques ne peut que souffrir de voir remis en cause, à peine instaurés, des équilibres délicats en matière de mours et de vie sociale. L’Église a confiance à la fois dans les ressources du vivant et dans l’ingéniosité des scientifiques pour trouver des voies de progrès médical dans le plus strict respect de la dignité humaine. Les crises sanitaires récentes nous montrent que, si certaines maladies régressent, d’autres apparaissent dans le même temps. Que la vie humaine puisse se développer à l’abri de toute maladie est un rêve hélas illusoire. A une époque où beaucoup est possible et où les moyens dont l’humanité dispose sont à la fois immenses et limités, c’est la fonction du politique que d’indiquer aux scientifiques le cadre humain dans lequel leurs recherches peuvent se développer. |